Voici la nouvelle qui parle de bouche à oreille, de musique et de domination... en une unique publication.
Chaque partie est placée sous l'égide d'un album de post-punk des années 80 (en gros).
Bonne lecture :)
ANOTHER MUSIC IN A DIFFERENT KITCHEN – Buzzcocks, 1978

Il était une fois un homme de radio. Oh, pas un professionnel, juste un parmi les animateurs et les animatrices d’une radio associative. Il aimait ça, la radio. Et cet amour était d’autant plus fort qu’il avait été tardif. En effet, notre homme était un enfant de la télé et pour lui la radio ressemblait à sa vieille grand-mère, posée dans le coin de la cuisine tandis que la vie s’agite autour d’elle sans même lui prêter l’oreille. Mais s’il n’avait alors encore d’yeux que pour sieur téléviseur, la musique frappa bien vite à ses tympans. Et la musique, pour en découvrir, il comptait sur les copains, bien sûr, et sur quelques émissions de radio qui vous débouchaient les esgourdes.
C’était toujours du bouche à oreille, la même vieille recette. « T’as écouté le nouvel album des Cure !? », « T’as le dernier live pirate de Joy Division ? », « Ouah, tu m’as déchiré avec le skeud de Siouxsie ! ». Les k7, les LP passaient de mains en mains, de platine en platine. Un disque acheté servait de pitance à toute la bande. On était plus glouton que gourmet. On dévorait frénétiquement tout ce qui sortait… et qui était à notre goût. On enregistrait des émissions, les Black sessions comme nos cousins et cousines de la rétive Albion avaient enregistré les session de John Peel. On copiait, on compilait compulsivement. Lui, il allait jusqu’à faire ses propres pochettes pour ses k7, collage de figures du rock, de slogans punk, d’image de fête et de lutte.
Enfants du rock, ses grands-frères portaient la crête et crachait leur révolte électrique à coups de riffs nihilistes. Lui portait déjà le spleen du post-punk comme la croix à planter sur la tombe de ce siècle de massacres industriels et d’utopies en poudres. On était passé du rageur slogan « Do it yourself » au désabusé « Get on our own ».
À force d’écouter, lui aussi voulu donner de la voix - « J’en ai envie » - mais le chant, visiblement, n’était pas sa voie ! Il avait beau user ses griffes sauvages sur sa guitare il n’en sortait que des riffs sans rage. Il lui fallait s’éloigner de la pulsation de la musique, il n’avait pas le bon tempo. Par contre il savait faire rimer les maux sous la plume. Ces mots toutefois ne dansaient pas. Oh, ils ne tombaient pas à plat… au contraire, ils dressaient le poing, les points même : celui-ci qui s’exclame, celui-là qui interroge. Celui qui ancre la virgule virevoltante. Les doubles et même ceux que l’on met sur les i. Les trois petits qui font marcher la phrase sur la pointe des pieds jusqu’à la lier au point au final.
Il savait ce qu’il voulait faire de ces pages qu’il noircissait à mots couverts : les crier à micro ouvert. À 16 ans, il passa enfin de l’autre côté du mur du son, il devenait une voix relayée par les ondes jusqu’à des milliers d’auditeurs, plus ou moins attentifs. Ce fut une libération pour notre homme.
Il commença par des chroniques acerbes et bouffonnes sur l’actualité de la ville dans une émission foutraque animée par trois étudiants anars de la fac de socio. Il fit sa tambouille et apprit rapidement les ficelles du métier, d’autant plus que tout se faisait avec trois bouts de câble, quelques micros, une console de mix, une platine pour les vinyles et une bonne dose de passion qui ne compte pas son temps. Il fit la technique sur plusieurs émissions nocturnes, se fit une place dans une émission sur le ciné et moins d’un an plus tard, en toute autonomie, il lançait sur les ondes « Un skeud dans les oreilles », émission qui en une heure refaisait les 33 tours d’un disque, tirant des sillons les dessous de l’album. Anecdotes, influences, interview, le groupe, son histoire… il gravait la musique dans la plastique de son contexte historique. Et pour ça il invitait toute une bande de potes, plus complètement étudiants mais pas encore tout à fait profs, à disserter et refaire le monde. Une révolution sur vinyle en un tour de cadran. Le disque ainsi disséqué ne venait pas forcément de sortir, ce n’était pas une promotion au sens strict du terme. Un fait d’actualité, un souvenir pouvait décider d’exhumer une pépite punk inconnue, de dépoussiérer un classique du rock, ou de laisser sans réponse les auditeurs à l’écoute d’un tube gothique. Un skeud dans les oreilles, comme une tarte dans ta gueule, comme un pavé dans la marre, un poil dans la main, une couille dans le potage ou un cri dans la nuit.
Mais les ondes une fois libérées par l’État furent vite libéralisées par les médias privées. Les radios pirates, qui avaient si bien su résister au pouvoir des flics, durent déposer les armes face à la puissance du fric. C’était le revers du disque. Notre homme redevint un auditeur anonyme. Il ne lui restait plus que des souvenirs tournant autour de cette période de sa vie. « Je m’en fous », se dit-il et il en profita pour tracer son sillon sous d’autres latitudes. Au terme de ce voyage, il posa ses valises au Mexique. Il se prit dans sa trame comme une mouche dans une toile d’araignée. Il y avait tant de fils à tirer, qui chacun ouvrait sur une réalité différente de ce pays invraisemblable. Il ne fallut pas longtemps pour que la radio le rappelle à elle. C’était sa pile d’amour, sa façon à lui de recharger ses batteries. Il reprit sa fiction romance radiophonique et posa sa voix là où il l’avait laissé, sur une plage musicale. Mais lorsqu’il partit prêter l’oreille aux radios communautaires au Chiapas et au Guerrero, il en resta sans voix. Tout comme quiconque peut librement respirer l’air autour de lui, tous et toutes pouvaient lancer leurs mots sur le fleuve radiophonique. À certains horaires, très approximatifs, des émissions plus structurées étaient diffusées, mais le reste du temps la radio était une sorte de téléphone collectif, le lieu de discussion entre communautés.
Il vit ainsi un jour un jeune garçon arrivait au village sur son mulet. Il se dirigea vers la station de radio et remis un paquet à l’un des animateurs qu’il semblait connaître. Dans ce petit paquet il y avait une k7 sur laquelle une femme avait de sa voix gravé un message d’amour pour son fils parti à Gringolandia et dont elle n’avait pas de nouvelles depuis plus d’un an. La radio allait servir de relai, comme le garçon au mulet. Diffusé à l’antenne, le message de cette femme serait craché sur des haut-parleurs dans d’autres communautés. De là, un cousin, une amie, un frère, une tante, téléphonera le message jusqu’à ce qu’une main, quelque part, lance le message, bouteille numérique, à la grande mer du net. Parfois le message dérivait encore d’îlot en archipel, d’archipel en presqu’île, de presqu’île aux cinq grands continents : Google, Apple, Facebook, Amazone, Microsoft. De là, avec ou sans adresse, le message trouvera son destinataire, foi de Gafam.
Notre homme était fasciné par l’usage que faisaient ces peuples de la radio. Elle était le maillon d’une chaîne de communication où se retrouvaient toutes les strates technologiques quand dans le monde dit civilisé seule la couche superficielle comptait. Une couche qui se renouvelait très vite. Mais pour les communautés, ici au Chiapas, le monde ne fonctionne pas ainsi. Le temps n’est pas linéaire, mais circulaire. Telles des roues crantées, de tailles différentes, enchâssées les une dans les autres, s’entraînant dans une course aux courbes complexes et enlacées. Une mécanique de précisions qui délivrait une date en combinant les crans alignés des différentes roues. Notre homme eut l’impression en partageant quelques mois avec ces hommes, ces femmes, ces enfants que le monde d’où il venait, lui, devait se trouver sur la plus petite des roues, même plus celle des jours, le temps était venu des millisecondes. L’image d’un hamster qui tourne à l’intérieur de sa roue minuscule et qui s’enivre de sa prodigieuse sensation de vitesse… sans jamais avancer. Mais l’horizon du rouage n’est autre que le tapis qu’il fait rouler et sur lequel progressent encore et encore – sans efforts - les dominants. Notre homme, lui, fredonnait cet air frais et punk : I hate fast cars !
MUSIC FOR THE MASSES – Depeche Mode, 1987

Lorsque
notre homme retourna chez lui, dans l’ancien monde, ce monde que
l’on dit premier se transformait sous ses yeux. Piiiiim…
Graduellement. Pfffff... D’abord une impression. Piiiiiiim…
Vague. Pfffff... Comme le soupir pneumatique de la mécanique d’un
manège à sensations. Piiiimmmm… pffff ! Chacune de ces
respiration provoquant cris d’effrois ou d’orfraie. Rire franc ou
gras bilieux. Pimpf ! Mais aucun silence. Ni contraint,
ni contrit. La parole est d’or, le silence de mort.
La sensation diffuse que personne ne s’écoutait plus, que plus personne ne se parlait, gagnait notre homme. Les ondes, comme les rues, les sites comme les places, ne bruissaient plus que de commentaires ; ces longs monologues autocentrés, discours lénifiants, terrifiants, que chacun se tient à lui-même, essayant avec plus ou moins de talent de se convaincre de l’importance qu’ils se donne. Chacun espérant que sa petite phrase sortirait de son contexte, deviendrait the things you say. Il faut du punch on line ! Des Punchlines ! Alors comment taire ? Comment se taire quand ce qu’on dit permet d’avoir et tenir ses followers, courtisans des temps virtuels. La seule question qui vaille est de savoir qui enrôlerait dans son armée d’amis le plus grand nombre de followers, le plus de zouzes, de plus ou moins gentils virus, ou de colibris aux hauts faits d’une geste ridicule.
Pour ne pas disparaître, la radio devait (selon les décideurs) devenir (selon les marketeurs) un nœud de la toile. Pas que la radio. Tous les médias s’y mettaient. Journaux, télés. La radio se télévisait et ses voix, ces voix qui avaient porté notre homme dans sa jeunesse, cette voix filmée se devait d’avoir de la gueule. Ce qui distinguait le site de RadioFrance de celui de FranceTélévision ce n’était que la proportion de leur métier de base. Mais tous donnaient à lire, à entendre et à voir.
La radio désertait ondes et antennes pour le net. Et l’internet, celui des début, celui qui avait un temps pu proclamer d’un manifeste son indépendance, avait été privatisé. Dorénavant régnaient de belles et grandes gueules qui débitaient à vitesse grand V de l’infotainment à flots continus pour alimenter l’autoroute du buzz. Bruit de fond de la société de l’information. Il n’y avait de message que publicitaire. On ne s’adressait plus aux auditeurs, plus même à des catégories : ménagères de moins de 50 ans, CSP+. L’audience était la voie. L’audimat la cible. Animateurs, présentateurs, commentateurs, éditorialistes, spécialistes et analystes, la longue liste des invités généralistes, réalistes et sensationnalistes ne s’adressaient qu’à la masse informe qu’ils n’avaient même plus la prétention d’informer mais simplement de former. Il ne s’adressaient qu’à l’auditoire ou à leurs pairs, franchissant les limites de l’indicible, non pour s’en échapper mais pour s’y réfugier et y briller le temps d’un éclair ou faisant long feu au firmament des voix qui comptent des milliers de vues. Seul moyen d’être entendu de leur n+1. Et il en fallait des orateurs pour tous ces hauts-parleurs. Il fallait bien sûr une audience pour tous ces beaux-parleurs. Bien évidemment, quand on ne parle pour personne en particulier, on se parle à soi-même et on finit par s’écouter parler pour ne rien dire. Peu importe ce qui se disait, ce qui permettait de donner voix au chapitre aux pires impensés, il fallait que quelque chose soit dit. Pour alimenter l’océan médiatique à flots continus. Une belle bouche se fiche d’être écoutée attentivement, elle n’a besoin que d’être entendue distraitement pour gonfler la courbe de son audimat. De toute façon les grandes gueules n’écoutent rien ni personne et n’entendent que leur propre voix intérieure… la voix de leur maître.
Notre homme, en passionné radiophonique en était attristé mais il lui fallait l’admettre : la radio avait changé ! De sacré dans le passé, cette boîte à secrets - murmurés ou hurlés – transistor auquel il collait l’oreille le soir tard dans la pénombre de sa tanière adolescente, il ne restait rien. Nada. Nothing. Notre homme se souvenait avec nostalgie de toute l’énergie qu’ils mettaient avec ses potes à faire n’importe quoi pour ne pas plaire à n’importe qui. Leurs émissions – celles qu’ils écoutaient comme celles qu’ils diffusaient – n’étaient pas calibrées pour toutes les oreilles. Aujourd’hui notre homme avait la sensation qu’il pouvait allumer n’importe quelle station à n’importe quel moment de la journée il tomberait sur une émission faite à la démesure des masses.
D’affluence en influence, les mass-média avaient transformé les auditeurs en audimat. Les masses n’avaient jamais été la voie de la libération, elle n’étaient qu’un moyen pour qui savait les manipuler, un outil pour frapper ce qui dépasse. Les masses, qu’elles soient populaire ou ouvrière, n’émancipent pas l’individu, elles le fabriquent à la chaîne. La foule crée l’illusion de l’étendue des envies mais contraint à un désir commun. Chacun sa version, à chacun ses options. La masse n’a pas de forme, pas de sens mais des milliers de nuances. Elle est meuble, c’est une bonne pâte à modeler. Une Lolita, quinceañera dont la tête tourne, roule, tourneboule jusqu’à la perdre. Le peuple a besoin de l’amour étrange d’un leader lui susurrant I want you now. La masse, c’est ce mec un peu perdu, un peu chéper, qui n’a d’yeux que pour son dieu vivant, son pote behind the wheel, son meilleur ami, celui avec qui partir en virée, en vrille ou en couille. La masse est l’asthmatique bouche bée devant le charisme du chef de bande, le fan devant le chanteur du boys band, le nain devant le gérant géant du boys club.
N’écoutant que leur intérêt en général, les grandes gueules de la radio roulaient des pelles ou distribuaient des râteaux à l’antenne. Ils n’étaient pas là pour laisser l’autre s’exprimer mais pour mettre leurs propres voix en valeur aux côté d’untel, de hausser le ton face à telle autre, de poser leurs mots comme du miel sur la tartine patronale, de jouer les roquets mâchoire fermée sur le tibia d’un syndicaliste refusant de condamner la violence exercée par ses camarades sur quelque bien matériel. Les rois de l’audimat faisaient la pluie et le beau temps. Ils tiraient ce qui devait être su de ce qui devait être tu. Ils faisaient l’agenda qui faisait et défaisait l’opinion publique. Tous les matins les mêmes voix de petits et grands leaders, en boucle, à la chaîne, encore et encore. À longueur d’ondes ce tout à l’ego rejetait toute pensée vers l’usine de traitement des mots usés qu’était devenue aux yeux de notre homme, la radio. Le seul sens qu’il trouvait à tout cela, était un sens giratoire, tournant et tourné sur lui-même… Aux cercles et à leur diamètre notre homme préférait les dessins des coquilles des escargots zapatistes, ceux des sillons serrés d’un vinyle. La spirale ! Elle qui, lorsqu’on la parcourt, fait avancer, lentement, mais sans jamais marcher dans ses propres pas, qui n’oublie pas de nous faire faire le tour de la question, sans jamais tourner en rond. Une mélodie. Une chanson. Tout un album. Une ritournelle entêtante implorant : « Ne me laisse plus jamais tomber. »
Pornography – The Cure, 1982
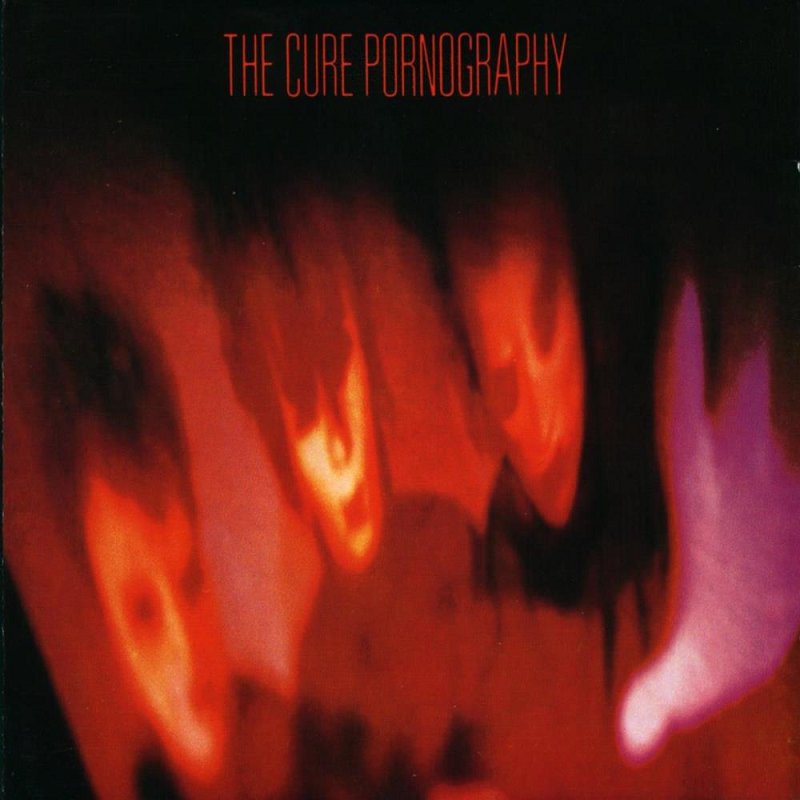
C’était pourtant une toute autre rengaine qui tournait en boucle, à longueur d’ondes, se répondait en échos de plateau en plateau, ricochait de site en réseaux sociaux : la petite voix lancinante de la liberté d’expression. À l’ère de la libre parole, ils étaient de plus en plus nombreux, les politicards, à se plaindre d’être victimes de censure, accusant les médias de fermer l’antenne à leur discours de haine. Le matin à la radio, le midi sur les chaînes d’info, repris l’après-midi sur la toile et toute la soirée sur les réseaux sociaux, ils se lamentait d’être empêché de dire ce que la fantasmée majorité silencieuse pensait tout bas, ou plus sûrement ce qu’ils avaient à dire. Il était obscène de voir à longueur de débats ou d’interview, d’émissions ou de reportages, certains se répandre sur l’atteinte à leur liberté d’expression quand des millions n’avaient pas voix au chapitre, à peine droit de citer.
Notre homme avait l’impression d’entendre cette indécente complainte depuis une centaine d’années. Il l’avait entendu plus jeune de la bouche d’un borgne bedonnant et fasciste, figure de proue d’un racisme décomplexé, frère siamois de ses précurseurs. À l’époque, il était aussi seul que le vieux tonton gâteux qui vocifère ses insanités aux repas de famille. Les corps des victimes de ses prédécesseurs n’étaient pas encore suffisamment froids pour que sa voix salace ait le droit de cité. Mais, à force de provocations, qui lui valurent condamnations morales, politiques et judiciaires, il traça son sillon dans un champ sémantique encore marginalisé en jouant sur les mots. Ses outrances lui permirent de forcer la portes des médias et, même si journalistes et politiques n’hésitaient pas à le sortir sans trop de ménagement, ils devaient pour cela, ouvrir la fenêtre d’Overton. Ses provocations impudiques instillèrent son discours dans le débat publique et il y planta ses idées comme autant de graines de la haine à venir. La vieille baderne raciste, sexiste, homophobe, jouait maintenant avec les maux d’une société se consumant par excès de consommation. Prenant le relai de la course à l’échalote présidentielle, ce fut sa fille qui fit valoir sa sacro-sainte liberté d’expression, brandie tel l’étendard souillé de sa dignité bafouée. Pas un plateau, pas une chaîne, pas une émission, pas un canal où ses lieutenants, dans une débauche d’effets spécieux, ne brandissent bravachement ce flambeau immonde. Les graines germaient et bientôt viendrait le temps de la moisson.
Et ils étaient nombreux à vouloir récolter les fruits de ce patient travail de gangrène idéologique. À tel point que concurrents du même courant ou détracteurs évoluant vers le même attracteur, tous et toutes se mirent à jouer les victimes de l’autel médiatique. Ça plaisait à celles et ceux qui jamais n’avaient accès aux feux de la rampe plus que leur quart d’heure de gloire réglementaire. Les coureurs de micros s’étaient pris en pleine face la méfiance grandissante des lecteurs-auditeurs-téléspectateurs vis à vis des médias et, chacun pour sa gueule, tentait de se faire passer pour victime du système médiatique dont il vivait pourtant grassement. La haine des médias était l’interface entre beaux parleurs et sans voix. Une haine affectée à la bouche. Une haine intrinsèque à l’oreille.
La ficelle était grosse mais elle tenait les auditeurs suspendus aux gesticulations des orateurs. Dans ce jardin suspendu les prédicateurs de frayeurs tenaient le haut du pavé. Les haut-parleurs bavaient leur fiel, pissaient leur venin et le creux de la voie se noyait dans cette aigreur immonde. De cette pudibonde pornographie personne ne sortaient indemne, ni orateurs, ni auditeurs. Tous étaient corrompus par le pouvoir et l’argent qui en découlait… ou par l’argent et le pouvoir qu’il instillait. Le trou noir médiatique avalait tout ce qui se trouvaient sous l’horizon des évènements et aucune lumière ne brillait plus. Pas le moindre phare pour brailler dans le noir, à peine quelque étincelle étouffée avec célérité par leur propre singularité.
Un effet à court terme de cette défiance envers les vendeurs d’infos fut qu’elle gagna le discours de l’autorité elle-même. Le gouvernement ne pouvait évidemment pas hurler à la censure en ce qui concernait sa parole, mais il distilla le doute, prétendant être systématiquement attaqués, à chaque article un tant soit peu critique, raillant la bien-pensance de la classe journalistique. Le président lui-même, enfant de l’ère numérique, tête d’ange au regard d’acier et aux dents acérées, ne fut pas le dernier à se lancer dans cette joute sémantique. C’était pour lui naturelle : c’était sa nature profonde qui parlait et un calcul politicien réfléchi.
Sa parole devait porter la solennité de la fonction, sa voix était celle de l’autorité, son verbe faisait loi. Ses mots parlaient à toutes et tous. Et lorsqu’il s’exprimait, c’était au nom du peuple tout entier. Il parlait pour tous, pour toutes, dans tous les sens du terme. Le président voulait sa parole précieuse et à l’ère des flux continus, elle devait donc revêtir une certaine rareté. À côté de ses propos présidentiels, il développa une langue qui se voulait plus « populaire ». Il prenait alors l’accent du sens commun pour distiller son mépris de classe. Il basa la com’ de l’homme dans l’habit de président sur ce qui avait si bien fonctionné en campagne : des apartés piquantes, censées emprunter à la langue de la plèbe son bon sens et sa forme directe. Il s’y vautrait comme dans le vice et le cynisme. Mais sous les mots familiers se cachaient toujours la même pensée : celle qui fait de celles et ceux qui ne réussissent pas des feignants, des sans costards, des hommes et des femmes qui n’ont pas le sens de l’effort, incapables de traverser la rue pour trouver un travail, des réfractaires, des illettrées… à l’opposé des mots élogieux employés par le président lorsqu’il ventait les dirigeants, ceux qui entre eux prennent et s’accaparent les richesses. Oh, ce n’était pas inédit, d’autres avant lui avaient dégainé le karcher face au bruit et l’odeur, fait des moulinets avec les poings escorté de gros bras, crié « cass-toi pauv’ con » à un sans-dents. Le président actuel avait même osé, sous bonne escorte, un « qu’ils viennent me chercher » à l’adresse d’une foule de mécontents.
Or, ce que les mots du président dévoilaient, c’était la bêtise crasse de sa classe et une méconnaissance du peuple, reconnues uniquement à travers des clichés éculés. C’était l’humour oppressant de sa caste, débarrassé de ses habits classes et qui avait revêtu de vulgaires frusques. Qu’il usa d’un ton de confidence, ou chargés d’ironie, ses propos apparaissaient toujours méprisants. Il était incompris ou délibérément mal compris. Il ne comprenait pas et hurlait au complot de l’opposition ou de puissances étrangères. Les journalistes, l’opposition, cherchaient forcément la petite bête à tous ses tics de langage. Il ne pouvait en être autrement. Les médias – qui avait largement contribuer à son élection – devinrent sa bête noire.
Le président ne pouvait crier à la censure, c’eut été incongru. Il préféra tirer la corde des « fake news ». Il lui semblait que la presse ferait un parfait bouc-émissaire en lui permettant de joindre sa voix à celle d’un peuple irrité par une presse engoncée dans une culture commune et bourgeoise. Oh, certes, leurs manières de voir le monde pouvait diverger, mais le point de vue - la ligne éditoriale, véritable ligne de fuite en avant commerciale - demeurait le même. Si tous ne regardaient pas les mêmes facettes du monde, tous voyaient par le biais des mêmes perspectives. Celles d’hommes, de quelques femmes, de pouvoir et de contre-pouvoir institutionnels. Le petit théâtre des cruautés de celles et ceux qui se mettaient en scène, aux fenêtres de tous les écrans. Et le président était le leader de ces dealers d’opinions, de promesses, flatteries dont ils vivaient, ça coule de source, aux dépends de celles et ceux qui écoutent.
Le président savait que ce qu’il reprochait à la presse était tout autre. Ce n’était évidemment pas sa servilité vis à vis des puissants, mais plutôt cette fâcheuse tendance qu’avaient encore quelques journalistes connus et reconnus à chercher des noises à quelque strart’uper disruptif, capitaine d’industrie installé, à quelque fleuron national de l’innovation, et même, ça va sans dire, à quelque politicien pris en flagrant délire. L’attaque sous l’angle des fake news lui permit même de compléter de façon inattendu la loi de protection du secret des affaires, passée peu de temps auparavant et qui réduisait les possibilités d’enquêter sur les multinationales de ses amis. Le président se frottait les mains de l’habileté avec laquelle il avait réussi, une fois de plus, à donner l’impression d’être auprès de son peuple, tout en en faisant retomber les bénéfices sur la caste qui l’avait assis sur le trône. Mais il dû vite déchanter. Contrairement à ses attentes, le peuple ne prit pas sa loi anti-fake-news comme une critique des médias, mais plutôt pour un rappel immoral à l’ordre économique des patrons de presse. Il faut dire qu’il avait, une fois de plus, lancé tel une locomotive folle, dans un discours devant mettre l’accent sur les responsabilités des patrons, l’une de ses petites phrases assassines qui faisaient dérailler la sérénité de son équipe de com’. Il inaugurait alors un nouvel incubateur de start-uppers, parlant sans notes, aux entrepreneurs au milieu de la presse, dans un ancien dépôt ferroviaire, il lâcha sans sourciller : « Une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c’est un lieu où on passe. Parce que c’est un lieu qu’on partage ».
Le président n’avait pas compris pourquoi cela avait tant choqué. Il était décidément un incompris. D’autres avant lui avait parlé de ceux qui ne sont rien. Même L’Internationale exhorte : « Nous qui n'étions rien, soyons tout ». Alors, quand son équipe de com’ lui expliqua qu’il aurait dû dire « les gens qui n’ont rien », le président les envoya chier. Sans doute avaient-ils raison sur la forme, mais au fond, ça ne changeait rien. Ça prouvait juste que ce n’étaient pas les mots mais bien sa personne qui était attaqué. Des gens qui n’ont rien, des gens qui ne sont rien, pour lui c’était limpide, c’était la même chose. Quand on a rien, on est rien. Pour être, il faut avoir. On est ce qu’on possède. Nos biens sont notre bien être. Il en va ainsi depuis l’origine du monde. C’est une vérité ! Pourquoi donc ces fichus pouilleux, ces pouilleuses fichues, s’offusqueraient-elles qu’on nia leur existence ? Comment pourraient-elles se satisfaire d’exister sans posséder ? Les êtres, les objets que l’on possède finissent par nous posséder, semblait lui répondre une rumeur de la foule. Il éclata d’un rire étouffé par une certaine gêne. Comment des objets pourraient-ils être ses maîtres ? Comment sa voiture, sa maison, toutes ses possessions pourraient-elles le posséder ? Par quel miracle sémantique ce changement de sens pouvait-il bien opéré ? À force de dépouiller les mots de leur sens, le langage même perdait son intérêt. Si les mots ne veulent plus rien dire alors on peut leur faire dire n’importe quoi. Le président était incapable d’entendre ça, de comprendre ça.
Notre homme se rappelait le jour étrange où il avait entendu la sentence présidentielle à la radio. Il se souvenait l’écœurement ressenti à l’écoute de cette opposition entre ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien. Il y pensait parfois, souvent, tant et tant, jusqu’à dé-penser, tournant et retournant la petite phrase du grand homme, la grande phrase du petit homme. La disséquant, l’autopsiant,la dépeçant. C’était encore et toujours cette dichotomie entre les premiers de cordée et les premiers de corvée. La maladresse du président était presque drôle à force d’être naïve. On sentait bien au ton – que le président aurait voulu chaleureux mais qui sonnait froid comme un hall de gare - de sa harangue que le président – au-delà de l’aréopage présent – voulait parler à son peuple. Une façon de mettre en scène l’adresse aux bons bourges de se préoccuper des pauvres bougres. Mais la pensée profonde du président refaisait surface à travers ses mots improvisés. Les gens qui ne sont rien. Notre homme repensa à la phrase d’Albert Camus : « Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme ». Puis il prit la tangente dans les mélodies les plus crues des Cure. « Give me your eyes, that I might see the blind man kissing my hands. », susurra-t-il, emporté par la musique vers des rivages dont le sable scella ses paupières.
CLOSER – Joy Division, 1980

Des semaines, certainement des mois plus tard, notre homme prit le temps de regarder la vidéo du discours pestilentiel. Il en resta coi. Lui qui avait depuis des décennies maintenant la sensation que celles et ceux qui prenaient la parole n’étaient plus rien d’autre que de grandes gueules, dû se rendre à l’évidence, son impression prenait corps. Ce qu’il n’avait jusqu’alors perçu que dans le grain de voix des hommes et femmes de radio gangrenait l’image. Il était le spectateur effaré d’une exhibition d’atrocités. Le président ne mâchait pas ses mots mais son propre visage. Plan serré. Son nez qui, par le gosier, fut avalé le premier. Gros plan. Ses yeux roulèrent de leurs orbites aux commissures des lèvres, en longèrent l’ourlé avant de choir dans la cavité buccale et qu’un coup de dents net ne tranchent les nerfs optiques. Zoom. Ses oreilles furent entraînées par le glissement de la face présidentielle jusqu'à la faille vestibulaire où s’agitait une langue frénétique. Très gros plan. Son menton remonta avec un filet de bave aspiré par l’orifice langagier qui ne cessait de croître. Nouveau zoom. Enfin, son front s’enfonça à son tour vers l’effondrement gigantesque, trou bordé de lippes énormes d’où s’échappaient encore des trains de mots insensés. Zoom arrière / plan rapproché. Au-dessus du costume, toujours attaché par un cou fin et agité, trônait dorénavant une bouche immense coiffée de la chevelure de l’homme en habit de président, telle une moustache ridicule.
La transformation était invisible si on ne regardait la vidéo qu’une fois. Mais notre homme la regarda encore et encore, tant et tant, enchaînant joint sur joint, jusqu’à ce que le lent déroulé de la métamorphose ne s’impose à ses yeux. Comme on déroule le négatif, image par image, pour dévoiler le film. La séquence trouvée sur le net ne durait en elle-même qu’une minute trente sept. Il fallait enchaîner vingt cinq visionnages pour que la métamorphose opère. Et il avait répété l’opération près d’une dizaine de fois. Lorsqu’il arrêta, s’effondrant dans son canapé, notre homme avait devant les yeux, sur l’écran de son ordinateur, un visage qui n’était plus que lèvres charnues et membraneuses, une figure effacée de sa propre face. Notre homme ne savait que penser. Était-ce réel ? Est-ce qu’il délirait ? Était-ce un morphing glissé sur les images de youtube par un facétieux hacker ? Son esprit lui faisait-il prendre des vessies pour des lanternes ? Était-ce un moyen pour une fin ? Une hallucination collective qui – enfin – montrerait la véritable vacuité des beaux parleurs ? Une sorte de métaphore visuelle... une métaphormose ?
Émergeant peu à peu du brouillard épais dans lequel il était plongé, il prit conscience qu’il venait de passer près de six heures à visionner la séquence. Il l’avait mater, remater, jusqu’à démâter, restant quelques minutes abasourdie entre les séances, sans ressentir la faim ni la soif, pas même l’envie de pisser. Il avait été comme avalé lui aussi, par la fascination de ce qu’il avait vu. Il était tombé dans une faille spatio-temporelle d’où il semblait maintenant réussir à s’extraire. Il reprenait pieds peu à peu, se leva et sortit dans son bout de jardin. Il ôta ses vieilles docs Martens, ses chaussettes et foula l’herbe sèche en soufflant comme pour évacuer l’air emprisonné dans ses poumons. Ce qu’il avait vu lui avait coupé le souffle et il avait besoin de sentir maintenant ses pieds s’ancrer dans la terre. Ses orteils fouillaient le sol, s’enfonçaient comme les racines profondes de son humanité. Il leva les bras au ciel, écartant les doigts comme les branches d’un arbre, tourna son visage vers le lune brillante et respira, longuement, doucement, profondément. Et il se mit à pleuvoir. À verse. Il resta encore un moment, giflé par la pluie, balayé le vent.
Après sa nuit d’horreur, façon pochette criarde du Kiss me Kiss me Kiss me des Cure, notre homme avait pris sa journée et la passa chez lui. Son cerveau lui faisait l’effet d’être un chewing-gum, mâchouillé puis recraché par les lèvres géantes qui, médiatisées à l’excès, faisaient de son esprit leur colonie. Quelque fut le média qu’il ouvrait, il y avait une bouche gigantesque à l’antenne. Et il en ouvrit des médias dans les vingt-quatre heures qui suivirent. Les transformations touchaient en premier lieux – cela ne l’étonna guère – les langues les mieux pendues, les belles gueules aux dents longues et aiguisées à force de rayer le parquet des palais du pouvoir. Les voix de la com’, les grandes gueules des talk-show, les penseurs médiatiques et autres spécialistes patentés et pourtant tant tentés par les feux de l’actualité. Les journalistes. À celles des grands médias, s’agrégèrent ces nouvelles voix issues des autoroutes numériques. La caste réduite des écrans, petits et grands, des ondes modulées, en fréquences ou en amplitudes, avait explosé avant de se reconfigurer. Mais les voies du net étaient aussi impénétrables que celle du seigneur, pour qui n’a pas les bons codes, les logarithmes du paradis, nouveau paradigme en matière de rythme de vue. Ces nouvelles voix, influenceurs, youtubeurs, étaient élevées en batteries dans de gigantesques silos par des méta-propriétaires de données. « Si c’est gratuit c’est toi le produit », prétend l’adage de l’âge digital.
Le net avait un temps donné la possibilité aux anonymes de se faire entendre sur la toile. Mais le net des débuts avait subi le même sort que les radios libres : très vite privatisé ! Oh oui, certes, tous et toutes étaient encouragé.e.s à s’exprimer, à donner un avis sur tout. Chaque ego devenait la chapelle individuelle à défendre contre vents et marrées et surtout contre tous et toutes. L’Autre. Le différent. L’individu glorifié dans son collage personnalisé de données, de connaissances, de compétences, de projets, de réseautage, dans le subtil équilibre des sentiments, des ressentiments, des amitiés, des inimitiés, de couleurs des taux ou de douleurs de peaux, des taxes, des cracks du cac... 40 voleurs jouent à la bourse le coût de la vie de celles et ceux pour qui elle n’a pas de prix. Et ça krach. Nulle différence de classe. Aucune distinction de race. Pas plus que de diversité de genre. Un avatar n’est d’aucune minorité. Juste la majorité tellement silencieuse qu’on peut lui faire dire ce qu’on veut, si tant est qu’on ait un peu de gueule. Rarement un mot plus haut que l’autre, mais une pensée toujours plus basse. Et si dans ce désert de prêches de malheurs quelques voix sages résonnaient, elles l’étaient moins en parole qu’à la manière d’images.
Les bouches donnaient chair aux voix. Elles étaient l’appareil phonatoire des êtres humains. Au-delà des lèvres volubiles pointaient une langue, le langage, la culture, une vision du monde. C’était la caisse de résonance du palais et ses vibrantes cordes vocales. C’était un gouffre. C’était un souffle. La bouche ouvre aussi sur la respiration. C’est une pause. Un silence. Une inspiration avant que le souffle même de la vie porte nos grandes idées ou nos petits malheurs, les mots sous toutes leurs formes, les noms propres ou les communs, toute la clique des adjectifs, les verbes évidemment, conjugués pour chaque personne à tous les temps et sur tous les tons, les mots de liaison, ces petites attentions qui mettent de l’huile dans les rouages. On s’inquiète ou on s’agace. « Mais où est donc Ornicar ? ». Il articule les propositions, quitte à se mettre parfois en mauvaise posture.
Il y avait tant de bouches. Trop de bouches déformées par la haine, quand les maux se changent en mots crachés. Et tant de mots sur les lèvres. De gros mots ou des petits mots gentils. Des mots doux, d’autres salaces. Des sucrés et de bien épicés. Des mots hurlés, d’autres susurrés. Des tendres et des mots durs. De ceux qui blessent. Aussi des mots qui réconfortent, parfois. Trop rarement des mots d’excuse. Tous ces mots qui s’échappent des bouches ouvertes, qui en tombent ou y montent, ces lèvres qui disent tous les mots qui leur viennent à elles-mêmes. Beaucoup de mots qui dépassent la pensée, cette grande absente. Car le monde des bouches était paradoxalement celui du silence de leur petite voix intérieure. Les bouches ne voulaient pas que tous leurs mots, les seuls qu’elles entendaient encore, tombent dans l’oreille d’un sourd, ou pire encore dans une de celles qui ne veulent pas entendre. Les bouches, elles, étaient incapables d’écouter. Elles n’entendaient que ce que d’autres bouches leur disait dans l’étreinte des museaux. Dans un sourire ou une grimace, dans un pincement ou un bâillement réprimé. Dans un bouche à bouche. Et certaines bouches avalaient de véritables couleuvres de bronze coulées par d’autres trous bêlant quand d’autres montraient les dents, serraient les mâchoires à saigner des gencives… quelques-unes, plus rares, mordaient quand la langue n’était plus assez tranchante, et que les lèvres n’étaient plus mêmes lues.
La bouche symbolisait le sens du goût, même si le sens en est parfois plus discutable que le goût lui-même. Le plaisir de la bouche… les plaisirs ! Car la bouche c’était aussi le baiser, langoureux ou passionné, interminable ou fugace. La langue sert à lécher, danser sur un gland ou à titiller un clito, les lèvres sucent, enserrent comme un anus. Les lèvres, supérieures ou inférieures, grandes ou petites, embrassent en un mot leur propre double-sens, un 69 qui met cul par-dessus tête, ce mot qui lie cuisine et cul, qui relie parole et silence. Les dents mettent, elles, parfois quelques petits coups dans une épaule, prises de fièvre charnelle. La bouche représentent l’amour. Métaphore sensuelle. Images sexuelles. On dévore comme on aime ! On se repaît de ce(ux) qu’on aime.
Les bouches incarnaient la société ou la République. Oh, il y avait bien parmi elles quelques voix honnêtes, des mots rares et cinglants, voire même une parole radicale. Il y avait des bouches qui étaient des porte-paroles, des porte-voix, c’est vrai. Des voix qui avaient encore cœur et âme. Mais elles faisaient partie de ces gueules dont les médias attendaient qu’elles fassent le buzz. Et elles s’en délectaient. Elles n’étaient pas bouche pour rien. Elles aimaient d’autant plus s’écouter parler qu’elles parlaient pour les autres… plus vraiment à leur place, mais en s’adressant à elles, pour montrer à quel point elles les représentaient bien. Leur langue s’en gonflait d’orgueil. Les propos de ces bouches savantes étaient intéressants mais leur volonté d’incarner la voix des sans-voix les disqualifiaient à l’évidence. Notre homme vit même dans une émission de nuit, une bouche mutique. Elle n’avait pas perdu la voix mais contestait la voie que prenait le monde, et en conséquence menait une grève de la parole qui ne rompait pas le silence sémantique qui entourait sa présence médiatique, un cri muet aux yeux du monde. Elle était une voix à l’isolement, en exode, sorte de nouvelle Pâque de la parole sacrée. Une absence de sentences que ne pouvaient percevoir les spectateurs passifs, toujours et encore abreuvées à flux continus par l’éternel bavardage médiatique. Un véritable floutage de gueule.
PHANTASMAGORIA - The Damned, 1985

Le lendemain notre homme se leva tôt, tiré dans un cri de ses songes hantés par des bouches, des gueules, des lèvres, des langues, des dents, des mandibules, des mâchoires, des museaux se pourléchant les babines, prêtes à l’avaler… images réelles, artificielles ou allégoriques ?! C’est un rêve. Mais non, pas même un cauchemar… la réalité dans sa terrifiante vérité ? Il ne savait plus. Il avait l’impression d’avoir passé deux jours sous trip. Ou deux nuits de fièvres… comme lorsque enfant, il regardait tournoyaient les ombres de sa lanterne magique. Petit, il avait été fasciné par cette merveilleuse lampe de chevet. Ses parents y déposaient une sorte d’abat-jour métallique sur lequel se découpaient des silhouettes d’animaux fantastiques. Les ombres géantes projetaient ainsi sur les murs de sa chambres un petit théâtre fascinant et quelque peu effrayant. Combien de fois avait-il noyé les divagations liées à la fièvre dans les fictions que jetait sur ses murs les personnages de son petit théâtre d’ombres ? Il avait très vite découpé dans du carton de petits accessoires pour les silhouettes gravées de sa lanterne, multipliant ainsi à l’infini le rendu des contes. Aux fables enfantines façon Winnie l’ourson, il fit succéder les aventures rocambolesques d’un Grimly Feendish – qu’une cousine anglaise lui avait fait découvrir - puis plus tard les mythologies amérindiennes ou grecques, celles des Troyens… avant que ce terme ne désigne pour lui une bande de skins antifa.
Notre homme se demandait s’il devenait fou. Les bouches qu’il avait vu étaient-elles réelles ? Ou bien était-ce lui qui les avait imaginé ? Dans la salle de bain, il fixa l’image inchangée de son visage mangé par une barbe broussailleuse et des cheveux en désordre de bataille que lui renvoyait le miroir accroché au mur ; lui se raccrochait à l’illusion que tout cela n’était pas l’œuvre de son cerveau malade. Après tout, il s’agissait peut-être d’un bug informatique. Un filtre snap échappé de son chat et hackant le monde virtuel. L’attaque théoriste d’une menace hacktiviste? Mais l’échelle de l’altération la rendait peu probable. Alors le mal était dans son regard, sa propre vision du monde. Le saint des saint de sa personnalité. Son esprit loin d’être sain maniait-il les influx des autres sens afin de façonner l’image qu’il se faisait du monde. Une manière d’imager cette distinction opérée entre celles et ceux qui ont un accès à la parole publique, et ceux et celles qui ne peuvent qu’écouter, sans rien dire. Il fixait le miroir. L’image réfléchie était toujours lui, qu’il fut ado ou adulte c’était toujours lui. Il savait qu’il avait changé mais il n’avait pas vu le changement opéré de jour en jour. Pourtant selon le moment de la journée, en fonction de l’éclairage ou même de son état d’esprit, l’image que le miroir lui renvoyait évoluait. Ce n’était pas toujours les même détails qui ressortaient. Parfois son nez lui semblait trop grand ou ses yeux trop petits, sa peau gonflée ou son visage plus rond. Ou peut-être la métamorphose était-elle réelle ?! Pouvait-il s’agir d’une mutation génétique ? La pression extraordinaire exercée par le surpoids de l’information aurait-elle poussé à la sélection d’une nouvelle façon de percevoir le monde ? Mais si c’était le cas, pourquoi ce prodigieux silence médiatique ? Peut-être que si personne n’en parlait c’est parce qu’un peu à son image, tous et toutes se voyaient tel.le.s qu’iels l’avaient toujours été, dans les grands traits, même si ceux-ci sont toujours un peu plus tirés. Bouche, oreilles, nez et yeux étaient à leurs places et à leurs tailles respectives. Peut-être que la métamorphose incluait de ne pas la voir à l’œuvre sur soi-même. Comme si la mutation impliquait une fabuleuse cécité auto-centré. Ça n’avait pas de sens. C’était bien trop alambiqué, trop capillotracté. Il en avait marre de manier le rasoir d’Ockham ; il avait la sensation qu’au fil du temps il y perdrait la tête. Le plus simple, le plus sage, c’était de se penser fou dès à présent.
Notre homme vit glisser sur son reflet l’ombre de l’amour. Il saisi son téléphone et appela sa compagne. Elle ne répondit pas et il ne laissa qu’un message succinct et bien trop flou. Comment dire ce qu’il avait à dire à un répondeur ? Mais il ne pouvait rester seul face ce qui le hantait. Il appela Cat et dix minutes plus tard, et la rue des rêves traversées à la hâte, il était assis dans le salon/kitchenette de son vieux pote, un arôme de café leur chatouillant les narines. Notre homme n’y alla pas par quatre chemin et asséna directe : « Tu… tu les vois aussi toutes ces grandes bouches ? ? Hein ? J’veux dire, tu vois aussi toutes ces stars des écrans, ce ne sont plus que des grandes gueules. Enfin, ils n’ont plus de visage, juste une bouche énorme. » « Ouais, je vois ça aussi... », lui répondit Tom. « Oh, la vache. » lâcha notre homme dans un grand soupir de soulagement. « Oh, merci... je croyais que je devenais fou. Ça fait deux jours que je ne vois plus que des bouches géantes partout sur le net ! » Notre homme semblait ne plus pouvoir s’arrêter de parler. « Non, j’en étais vraiment venu à me dire que j’étais soit fou, soit sous trip. Mais bon, ça fait un bail que je prends plus de psilo. Alors, à moins d’un vieux retour d’acide… Ben du coup, quand j’ai vu le président se transformer, puis les autres, il me restait quoi, à part ma propre folie… » « Ok, ok, ça va. Du calme, mon ami. Je te dis que je les vois aussi. Et moi aussi, ça me fait flipper. Bien plus que triper. Mais je me suis dit comme ça, c’est un problème de communication. Il y a donc trois sources d’erreur possibles. L’émetteur, le média et le récepteur. Alors l’émetteur. Il n’y a pas qu’un émetteur, la métamorphose semble toucher tous les principaux émetteurs, TF1, FranceTélé, M6, les chaînes du câble, les principaux sites d’info du net, de la radio, les chaînes youtube... »
Tom avait hacké le monologue de notre homme et la discussion prit place entre eux, échangeant arguments et fou-rires. Ce n’était pas le dérapage présidentiel qui avait mis la puce à l’oreille de Cat. Ça avait été la voix chevrotante d’un ministre d’état explosant en direct. Le triste ministre était mal dans ses pompes. On lui imposait une danse de petits pas sur le rythme endiablé du changement climatique. Sa voix jouait la partition de l’impuissance feinte mais Cat entendait dans ses mots le tango triste de son ego blessé. Le sinistre avait accepté le poste pour parachevé sa trajectoire, mais l’écologie ne faisait pas le poids face à l’économie. Et le ministre Ushuaïa avait compris que son image n’avait servi qu’à greenwasher un quinquennat aux couleurs plus or et argent. Son orgueil souillé lui avait fait piétiner le protocole et sans crier gare, mais ragaillardi par les voix doucereuses des deux journalistes qui l’interviewaient, le sinistre leur offrit un scoop, posant sa démission en direct live dans la plus grande matinale radiophonique du PAF ! La Terre pouvait bien brûler, le service public était en état de grâce. Quel culot ! Quel coup de tonnerre dans le palais de Jupiter ! Jouant l’air ingénu du héro du huitième jour, le ministre perdait la face pour conserver son image. Cat avait perçu dans ce dialogue de sourds, dont les voix à l’unisson se vautraient dans ce coup de gueule, les lèvres charmeuses et les dents acérées qui dévoraient tout, corps et âme, yeux et oreilles. La vidéo qu’il en vit plus tard lui montra les visages des journalistes et du ministres jouer la même scène autophage.
Les deux amis avaient au départ envisagé un hack ou un canular comme origine des vidéos. Après tout avec un logiciel du genre de Reface, il était facile d’opérer un morphing sur des vidéos, même en direct. Mais ni Cat ni notre homme ne pouvait imaginer ça à l’échelle de l’ensemble des médias, sans verser dans un complotisme qu’ils rejetaient. Non qu’ils nient l’existence de complots. Des complots se trament, notamment sur la toile, ils le savaient, l’histoire regorgeait de ces actes ourdis en petits commités mais aux retombées parfois mondialisées. Il n’étaient aux yeux des deux hommes que la conséquence logique de l’organisation autoritaire de la société. Les complots dénoncés à longueurs de post facebook mettaient en scènes de petits groupes d’hommes, aussi occultes que leur pouvoir était censé l’être. Le pouvoir, lui, voyait un complot en tout regroupement de zadistes, en chaque action no-border, dans toute assemblée de luttes prolétaires, dans les réunions étudiantes, féministes ou minoritaires… qu’elles durent le temps d’une nuit debout ou d’un hiver attendu et jamais venu et dont il ne nous reste qu’une vieille photo jaunie. Les complots peuvent être fondés ou farfelus, mais ils n’étaient que des épiphénomènes dans une mécanique capitaliste où les attaques étaient en général bien plus frontal. Voir un complot derrière chaque décision prise en toute opacité, sans publicité, c’était ne pas comprendre l’organisation même du monde capitaliste. Bien d’autres luttes restaient à mener ! Non contre des chimères censément effrayantes, mais contre les conséquences bien trop réelles de décision prise en toute transparence, en commité d’entreprise ou en conseil des ministres.
Non, vraiment, l’émetteur n’était pas en cause dans le phénomène. Ces immenses émetteurs de sonorités humaines qui avaient envahis les écrans devaient avoir une autre source. Le média ?! Il était multiple. Le phénomène touchait toutes les formes médiatiques : chaînes du câbles, youtube, la télé bête et méchante hertzienne ou par satellite… et même la radio ! Tout d’un coup, Cat se leva, prit ses clefs, ouvrit la porte de son appart’ et sortit. Il revint quelques secondes plus tard, son courrier à la main. « Attends, j’veux vérifier un truc... » Il déchira le film qui emballait le papier glaçant de la Une du torchon municipale et se mit à feuilleter les pages intérieures où s’encraient l’angoisse de soi et la haine de l’autre. Notre homme saisit au vol la pensée de son ami. La presse papier était-elle aussi touchée ? Cat s’arrêta tout à coup sur une double page. L’interview d’un dealer d’opinions opposées à celles de l’actuel gouvernement. Opposé, tant qu’il faudra, jusqu’à ce que vienne le jour où, de leader charismatique de l’opposition, il soit lui-même le gouvernant actuel. Sur la photo, ses lèvres fines, sèches, décolorées avaient mangé le reste du visage du vieux briscard de la politique. Une cicatrice fendillant le côté droit de sa lèvre supérieur. C’était une bouche en costard qu’avait saisi l’œil du photographe. Une bouche hautement politique. Une bouche close pour une fois. Presque un trait ferme entre les commissures des lèvres. Ne s’y esquissait nul sourire. S’y jouait l’équilibre subtil entre la gravité du constat et l’espoir des promesses. Une belle photo aux couleurs d’un clair-obscur qui confinait au noir et blanc. Il y avait parfois du talent chez les esclaves de leaders d’opinion. Le papier aussi glaçait la métaphore. Le média n’était pas en cause.
Restait le récepteur. C’était là qu’en était arrivé notre homme dans ses réflexion personnelle. Il n’avait pas eu envie de plonger trop profondément dans une longue introspection afin de déterminer si ce qu’il voyait tenait de la folie ou du génie. Illusion ou hallucination ? Pareil pour Cat, qui en était arrivé à cette même remise en question de sa santé mentale. Mais ils étaient maintenant face à face, ayant posé les mêmes doutes sur la table, à côté des bol de café et du cliché glaçant. S’ils voyaient la même chose, la folie individuelle était d’ores et déjà exclue. Restait l’hallucination collective.
MASK – Bauhaus, 1981

Si l’illusion était générale, il fallait y réfléchir collectivement, soigner le mal par le mal. Les deux hommes décidèrent de réunir la fine équipe D’un skeud dans les oreilles. Cat appela Jack et notre homme, César. Ces deux-là ne se parlaient plus depuis un bail, depuis que des mots débordant la pensée de l’un avaient éclaboussé l’ego de l’autre. Ils acceptèrent de venir, sachant pourtant que l’autre serait là. On verrait bien une fois sur place.
Le rendez-vous était fixé au soir, chez notre homme. Avec Cat, ils discutèrent encore et encore des bouches géantes mais remuèrent aussi les vieux souvenirs, soulevant un épais nuages de poussière qui donnaient consistance aux rayons du soleil dansant à la fenêtre. Mais inlassablement la conversation retrouvait la pulpeuse réalité de la métamorphose toute kafkaïenne.
César arriva avec la fin de journée et Jack avec la tombée de la nuit. César était prof dans le collège d’un village non loin de là. S’il avait bien vu (lui aussi) les grandes gueules envahir les petits écrans, il avait pensé à un filtre (comme ceux que sa fille utilisait sur ses appels whatsapp) échappé d’une appli et qui aurait contaminé les supports numériques. La discussion était lancé et l’énormité des faits lui fit perdre toute animosité envers Jack (jusqu’au coup de froid de son arrivé).
De son côté Jack, sortant du taf, semblait emprunt d’une excitation toute en retenue. Ses yeux brillait du même éclat que leur adolescence radiophonique, le fantôme diapré de la passion des amants. Il tendit à César des lys jaunes, la main d’une amitié perdue et une perche. César adorait l’émulation intellectuelle qu’il sentait venir et se saisi avec empressement des lys et des restes.
Jack ne perdit pas plus de temps. Bien que travaillant pour la télévision, il n’avait vu aucune grande bouche sur ses écrans. « Mais, je ne filme que des docus animaliers. Dans l’œilleton de ma caméra je vois pas trop de visages humains et aucun avec une assez grande gueule pour que ça finisse par se voir. », justifia-t-il. La remarque de Jack fit tilter la matière grise de César. Pour lui, la transformation des figures médiatiques en bouches géantes suivaient une logique interne. « Elles s’articule en proie à des lois telles celles qui régissent l’univers ou l’organisation d’une cellule, qu’elle soit cardiaque, nerveuse, grise, de dégrisement, monastique ou terroriste. » Nos quatre amis distinguaient une certaine cohérence dans le déroulé de la transformation. La métamorphose semblait concrétiser le pouvoir symbolique que revêtait la parole médiatisée. « Une bouche est un chef. Quand il s’exprime, il le fait au nom de sa communauté », suggéra Cat.
Les bouches avaient en commun un pouvoir fondé sur la capacité performative de leur expression. Leurs mots produisaient des effets. Gens de médias ou gens de lois (ceux qui les font, ceux qui la disent), les prêchi-prêcheurs et leurs prêcha de malheur, spécialistes consacrés ou téléphilosophes, et pas mal de sacrés cons aussi, en fait, toutes celles et tous ceux qui avaient un accès régulier, suffisant pour au fil du temps dérouler leur vision du monde, à l’une ou l’autre fenêtre médiatique. Ce carnaval permanent des faux-semblants. Les bouches étaient partout dans les médias. Même sur les lives des grandes chaînes de télé, sur le net, elles déblatéraient, elles blablataient, débattaient, discutaient entre elles sans prêter attention à celles et ceux pour qui elles étaient censées parler. Cette mascarade perpétuelle relayait en boucle les injonctions culturelles d’une civilisation qui, pour ne pas disparaître seule dans la déraison de sa raison, entraînait dans sa chute, non seulement l’humanité entière, mais aussi massivement, plantes et animaux.
« Si les gens de médias et de lois se métamorphosent, les gens d’armes le devraient aussi », lança notre homme. « Après tout, ce sont eux qui donnent réalité aux dires de ses messieurs, qui plaquent leurs ordres sur la réalité. » « Et leur parole a force de loi », ajouta Cat. « C’est le cas des syndicalistes de plateaux tv », dit César. « Ouais, notamment les fachos d’Alliance ! », ajouta Jack. Le panel des habituelles figures d’émissions et de Jt était large. Et des bouches (du coup) il y en avait plein, de plus en plus et de toutes sortes, qu’ils tentèrent de recenser : des grandes gueules politiciennes, quelques gueules cassées des syndicats de travailleurs, des gueules grandes ouvertes de spécialistes en tous genre, d’autres plus mutiques, des moues, de lèvres pulpeuses. Des bouches séduisantes d’interviewers, d’autres devenues muettes face aux flux de conneries que déversaient en permanence leurs congénères. Quand celles-ci faisaient la fine bouche, d’autres étaient aphones à force de prêcher dans ce plein désert de brouhahas. Certaines en crevaient la gueule ouverte. D’autres, bouches bées, se noyaient dans le vacarme, buvant à plein poumons, ou tentant de recracher ce flot cacophonique qui s’immisçait par leur gueule béante et menaçait de les asphyxier. Il y avait également des bouches qui ne tiraient leur pouvoir ni de la médiatisation, ni de l’action politique mais de leur poids économique. Certains pesaient plus d’un pays. C’étaient eux qui murmuraient aux commissures des lèvres des journalistes et soufflaient leurs mots aux gouvernants. Ils n’avaient pas besoin de médiatisations (ils possédaient les médias) pour influer sur les destins de dizaines de milliers de petites mains qui elles, vivaient dans la crainte et plus encore dans la peur de la peur. Leur business-plan conçu en open-space ou en conf’call, visait à virtualiser le monde, à artificialiser l’intelligence, à mimer la vie elle-même, sans égard aucun pour la complexité de celle-ci, ni pour la profondeur de l’intelligence, pas plus que pour l’expérience du monde.
Le raisonnement de Jack, lui, restait bloqué sur la métamorphose en elle-même. Il voulait comprendre comment il voyait de grandes gueules, là où il y a peu encore, il voyait de simples visages. C’était pour lui comme un coup de pieds dans l’œil… et ça faisait mal ! César, en féru de littérature et de théâtre, fit entrer en scène l’idée du loup, du voile, du costume ou du camouflage. « Tout ça c’est un peu comme un masque, un accessoire sensé mettre en lumière la caractéristique d’un personnage et faire oublier la face de l’acteur. Si on est d’accord sur l’idée que les bouches symbolisent un pouvoir performatif et qu’elles effacent le visage d’origine, on peut voir cette transformation comme un masque. » Notre homme appuya en ce sens, mais en introduisant un angle anthropologique. « Le masque peut aussi être vu comme une manière de s’accaparer les caractéristique d’un animal, d’un esprit… il est le pouvoir de se métamorphoser en ce que l’on est pas. Chez bien des peuples, ce n’est pas seulement une manière de représenter mais bien de devenir, de s’approprier les pouvoirs de l’autre. » « Mais du coup, poursuivit César, se pose la question de la vérité. Qui est la véritable personnalité, celle du masque ou celle de celui qui le porte ? On sait bien que jouer, pour les acteurs, brouille la frontière entre réalité et fiction. Bien des acteurs estiment qu’ils sont plus en accord avec eux-mêmes lorsqu’ils jouent un rôle, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes. » Jack rebondit : « Donc, on ne sait pas si ce sont les bouches géantes qui sont vraies ou les visages qu’on voyait avant ? Alors est-ce que c’est réellement le pouvoir symbolique qui transforme les dirigeants en bouches ou est-ce que ce pouvoir revient finalement à ceux qui sont déjà des bouches. Avant on ne le voyait pas, maintenant si. Le masque ne fait que révéler ce qui était caché. » « Je sais pas comment tu fais mon pote pour toujours trouver un angle complotiste à toute hypothèse. Dire que le pouvoir reviendrait à celles et ceux qui sont déjà des dirigeants, par nature en quelque sorte, c’est oublier tous les mécanismes sociaux de la domination. Bien sûr, il y a une reproduction sociale à l’œuvre dans les classes dirigeante, comme dans les classes dirigées, mais de là à essentialiser et penser que le pouvoir choisit des élus, non, là c’est trop pour moi. Répondit Cat. J’ai rien contre votre idée de masque, je trouve même que ça facilite en quelque sorte le raisonnement, en gommant la recherche du pourquoi du comment, mais vous me perdez avec votre idée de réalité brouillée. Je suis pas un grand intello comme vous, mais j’aime bien l’idée de K. Dick qui dit que la réalité c’est ce qui continue d'exister quand on arrête d'y croire. Ou un truc approchant. Là, on a jamais commencé à y croire, aux bouches. Et pourtant elles existent ! On en est tous témoin. Donc, ok, elles symbolisent le pouvoir, mais elles ne donnent pas le pouvoir comme elles donneraient un baiser. Ça soulève quand même une autre question. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de bouche ? Pourquoi ne sommes-nous pas tous des bouches ? Après tout, nous avons tous des gens qui nous écoutent, des gens sur qui nos mots ont un pouvoir. Les parents sur leurs enfants, les profs sur leurs élèves, les amis entre eux… On a tous dans nos discours, pas tout le temps mais de temps en temps, ce caractère performatif des mots. Alors pourquoi ne sommes-nous pas tous des bouches géantes ? » C’est Jack qui répondit avec l’accent de l’évidence, et une pointe de revanche. « Eh bien, parce que nous ne passons pas tous à la télé. » Le débat s’intensifia et il aurait été vain pour quiconque de tenter de retranscrire les propos qui furent tenus en les attribuant à leurs auteurs, mais la médiatisation devint un thème central. La médiatisation, le fait que des propos soient relayés, diffusés, offrait à un discours une audience plus large. Pour nos amis, cela semblait essentiel. D’autant plus que, malgré les simagrées des uns et des autres sur le déni de leur liberté d’expression, il était évident que seule cette caste médiatique avait le loisir de se plaindre dans les médias de la censure dont ils se disaient victimes. Ils oubliaient une fois de plus les gens ordinaires, celles et ceux qu’ils sont censés (dans leur conception de la démocratie) représenter.
L’un des quatre amis objecta bien le quart d’heure warholien à l’absence complète de la plèbe devant l’œil médiatique, mais on remarqua que si micro-trottoir ou plateaux garnis d’inconnus fleurissaient, les gens du commun n’était que des témoins, tout juste bon à raconter ce qu’ils vivaient, avaient vu ou entendu. C’était du vernis sur une jambe de bois. Jamais le commun ne pouvait être acteur d’un évènement. Si on leur demandait leur avis, il ne fallait surtout pas qu’ils soit trop pointu, trop politisé. Au commun des mortels on ne demande pas d’analyse, on laisse ça aux spécialistes médiatiques. Au sens commun du peuple, on ne demande pas de résoudre des problèmes, c’est le domaine des politiques. Pourtant remarqua l’un des convives, il y a bien des journalistes qui posent la question de la corruption des élites, il y a bien quelques personnalités pour évoquer les violences policières. Mais lorsque ça se fait, le dispositif médiatique est agencé de tel sorte qu’il tourne en ridicule cette parole trop commune. Et s’il ne le faisait pas, le piège se refermait encore et toujours sur ces paroles libres, en les transformant elles-mêmes en bouches. Le système les médiatisait à l’excès, jusqu’à vider la bouche de son discours, que ne reste que lèvres pulpeuses ou bouches cousues de fil blanc. Que seule l’allure demeure, la vidant de toute substance. Il faut du brut, du vice, voir combiner le tout, pour que les clichés restent glaçants et que l’orgueil des stars continuent à se boursoufler telle des collines creuses. Pourtant, aux yeux de nos amis, les propos tenus par les spécialistes médiatiques avaient l’air tout aussi plat que les écrans de celles et ceux qui les regardaient. Si tous et toutes, par la grâce des réseaux sociaux avaient accès à la masse, le média ne suffisait plus. Il fallait une caisse de résonance. La plus part des gens se réjouissaient d’être des guitares électriques mais oubliaient que sans ampli elles faisaient encore moins de bruit que leurs cousines sèches, qu’elles regardaient pourtant avec mépris, les considérant comme des sans voix à qui il fallait tendre l’oreille pour entendre leurs murmures éclectiques.
La trotteuse trottait, entraînant petite et grande aiguilles dans sa course autour du cadran. Dehors, les premiers chants des oiseaux déchiraient le silence de la nuit et les premières lueurs de l’aube venaient gratter aux fenêtres comme un vieux chat cherchant à rentrer après une chasse nocturne. Les bouteilles s’étaient vidées remplissant verres et vessies qui à leur tour s’étaient épanchées. Clopes et joints avaient été fumés, emplissant les poumons et l’atmosphère, puis de mégots les cendriers. Et ces derniers avaient été vidés dans la poubelle appropriée. Nos amis avaient la sensation d’avoir des muscles en plastiques, moulés par la nuit blanche. Ils n’avaient plus vingt ans et le manque de sommeil pesait de tout son poids sur leurs corps alanguis et leurs consciences évanouies. C’est Jack qui sonna le clairon et proposa d’aller prendre le soleil et un café en terrasse. Il avait les cheveux en pagaille et les yeux rougis par la veille nuiteuse. C’est César qui (en le voyant) se souvint de son surnom à la grande époque : « Hé, mais c’est le retour de l’homme aux yeux de rayon X ! »
THE MOON LOOKED DOWN AND LAUGHED - Virgin Prunes, 1986

Au café, sous un soleil qui bien que matinal n’en était pas moins estival, les amis reprirent quelques couleurs que la nuit leur avait barboté. Ils baguenaudèrent sur le temps, celui qu’il fait et celui qui fait et défait les amitiés. Les quatre potes étaient heureux de se retrouver et leurs sourires rayonnaient, malgré des yeux fatigués. Un instantané de paradis, fugace. Un peu plus loin sur la place, face à eux, se dressaient les étales du marché. Promeneurs et clients se laissaient happer par les couleurs des fruits et des légumes, par les odeurs de fromages et de fleurs, grignotaient des yeux ou du bout des dents un bout de pain croustillant. Les voix criardes que les marchands adressaient aux chalands parvenaient jusqu’aux clients des terrasses alentour. Aucune des grandes gueules du marché, ces hommes et ces femmes tonitruantes, pas une de ces voix de poissonniers ne sortaient d’une bouche géante. Haussez le son ne suffisait pas à faire d’elle, d’eux des gueules pareilles à celles des pros de la politique ou des médias. La métamorphose avait, elle aussi, besoin des écrans pour exister, d’être médiatiser. Les noirs miroirs reflétaient une réalité déformée.
Lorsque la métaphormose reprit petit à petit possession de la discussion, ce fut sur un ton plus léger. Il y eut même quelques éclats de rires pour se ficher aux commissures des lèvres de chacun d’eux. Après tout il y avait dans la situation un côté burlesque, et sans doute même absurde, qui prêtait autant à sourire qu’à philosopher. « Et si les grandes gueules sortaient des écrans et envahissaient les rues. Vous imaginez que les gens qu’on croise ici ou là, chez le disquaire ou à la librairie, ou là, au marché… tous et toutes ne seraient plus que des bouches immenses », osa notre homme. « Oh oui, imaginez ça à la Romero - enchaîna Jack - Des bouches géantes qui coursent des hommes et des femmes pour les mordre... » « Non, pas les mordre, les embrasser. Une sorte de baiser de la mort, de bouche à bouche contaminant. » « Yep, une sorte de folie collective avec des gens qui courent en tous sens, bras en l’air, fuyant ces lèvres pulpeuses prêtes à les étreindre. Et les lèvres qui déambulent comme des poulets sans tête, avant de la faire perdre à leur tour à d’autres. » « La métamorphose cernant de plus en plus prêt le héros du film. Les bouches engloutissent tout autour de lui. Il se voit comme emporté par la foule de baisers, tendant les bras et la face vers le ciel, l’œil taquin et objectif de la caméra. Il hurle un long « nooooooooooooon ! » qui déforme sa bouche. Plus il cri, plus sa bouche gonfle et plus le reste de son visage disparaît dans le néant. N’émerge plus des successives vagues labiales qui le lèchent que sa propre bouche tordue en un cul de poule et aux dimensions désormais disproportionnées. » Jack mima le clap de fin. « Alors un héro à la Chaplin ou Keaton. » « Ah oui, je dis bravo au réal ! » Et tous applaudirent et partirent en franche rigolade. Jack tenait ce petit moment de gloriole dont il raffolait. Mais comme souvent il allait d’un même élan, lui opposer sa propre trahison. C’était là son pêché mortel... si mignon.
« Peut-être que les dirigeants, pour asseoir leur pouvoir vacillant, nous ont inoculé une puce qui agit sur la manière dont notre cerveau traite les informations visuelles. Après tout, l’image que nous nous faisons du monde naît des informations perçues par nos sens – et chacun d’entre eux est influencé par les autres – qui sont ensuite filtrées, traitées, par notre cerveau qui nous projette une image mentale du monde. » Cat et César éclatèrent de rire. La rumeur des puces implantées à notre insu fait partie du catalogue de la pensée complotiste. Mais notre homme les fit taire. Non qu’il prenne au sérieux l’histoire de la puce, mais le raisonnement de Jack mettait en lumière le caractère chimérique du monde tel que nous le percevons. « Mais, si tu écartes l’hypothèse complotiste de la puce... », commença Cat quand Jack l’interrompit. « Oh, ça va. Les complots ça existe. Je te donnerai un seul exemple : les armes de destruction massives en Irak. Ça a quand même coûté une guerre et la destruction d’un pays... au minimum. Parce que derrière on pourrait y ajouter les attentats du 11 septembre et l’invasion et la mise à sac de l’Afghanistan. C’est une histoire vraie ! Alors, tes airs condescendants sur mon supposé complotisme, ça va aller ! » « Ok, excuses-moi Jack. Ce que je voulais dire c’est que le caractère chimérique du monde qu’on voit, ça revient à se dire qu’on est tous fous. Une folie collective. » « Mais une folie qui est tue de tout temps. Renchérit notre homme. Tu as parfaitement raison, le cerveau doit traiter une somme incalculable de données. Il doit faire un tri et ne garder que ce qui est pertinent pour la conscience. Et ce tri se fait en fonction de l’évolution mais surtout de notre éducation. Selon la culture, nous n’allons pas remarquer les mêmes éléments d’une même scène. Entre hommes et femmes, nous ne voyons pas les mêmes détails, car on ne nous apprend pas à porter note attention sur les mêmes aspects du monde. Pas besoin d’imaginer d’implants… nous sommes soumis à tellement des informations visuelles qui dressent nos esprits à voir ce que les vendeurs de temps de cerveau disponible veulent que nous voyons. » Cat reprit la balle au bond : « Pour l’instant on ne sait pas si d’autres personnes sont aussi folles que nous. » « Ah si ! reprit de volée César. Ma femme aussi voit les bouches. » « Pareil pour MES meufs », fit Jack dans un sourire (dont la lourdeur étirait bien trop ses lèvres) que les autres lui firent ravaler aussi sec. « Ok, vous en avez donc parlé avec vos compagnes. J’ai laissé un message à Virginia mais elle ne m’a pas encore rappelé. Mais y a-t-il des gens hors de nos cercles proches qui les voient ? Parce qu’on peut supposer que nous, nos proches, posons un certain filtre sur le monde, un masque sur des visages banals. La vision que nous en avons est influencé par nos idées. Jusqu’à maintenant ce filtre était idéologique. Là, il devient… optique !? Est-ce qu’on pourrait supposer que des cerveaux sursaturés d’infobésité puissent muté, comme ça et rendre visible à nos yeux ce qui n’était encore qu’une image littéraire ? » César continua. « Je trouve cette idée intéressante ! La métaphore qui devient réelle. Une illusion autocentrée. Une métamorphose métaphorique… Une métaphormose... » Notre homme éclata de rire. « Bordel ! J’ai imaginé le même mot le soir où j’ai vu le président se changer en grande gueule. » « On est toujours connecté. » « Aahh, l’amour dure toujours, mon ami... »
L’agencement des personnalité des quatre amis redonnait forme au groupe qui avait animé Un skeud dans les oreilles, il y a une bonne vingtaine d’année. D’ailleurs Cat illustra à merveille ce sentiment qui traversait l’esprit de notre homme, en ramenant sur terre les idées chépers de ses camarades. « Ok, ok, tout ça c’est super, les métaphores, les métamorphoses et les méta… phormose. Mais ça nous avance à rien. Je pense qu’il faut comprendre le pourquoi de cette transformation. Le comment, c’est une question qu’on peut laisser aux chercheurs, sociologues, anthropologues, ethnologues et autres logues. On avait commencé, avant tous vos délires, à faire émerger un schéma. Les bouches symbolisent le pouvoir performatif des orateurs. C’est là-dessus qu’il faut qu’on réfléchisse. C’est là-dessus qu’on peut espérer agir. Ne pas regarder en arrière. Parce que si votre hypothèse de l’image idéologique qui devient visuelle s’avère vraie, ça ouvre des perspectives. On peut par le bouche à oreille infecter la multitude et espérer fomenter une révolution ! ». « Tu veux initier un complot ! » ricana Jack. Notre homme fit taire les rires qui commençaient à arquer les lèvres des convives et Cat qui allait bondir au visage de Jack. « Attendez, attendez… L’idée de Cat n’est pas bête. Il y a un truc qui me chiffonne depuis qu’on parle de tout ça. Cette nuit, on se posait la question de savoir pourquoi tout le monde n’était pas bouche. Je crois qu’on oublie quelque chose. Si les bouches symbolisent un certain pouvoir, alors il doit y avoir des gens sur qui ce pouvoir s’exerce. Sinon, il n’y aurait rien à symboliser. » « Tu penses donc que nous, celles et ceux qui ne nous transformons pas, nous sommes celles et ceux dont les vies sont modeler par les mots des bouches ? C’est bien ça ? » « Oui, ça me semble évident. » Ils tirèrent sur le fil de cette pensée afin de définir, en contraste, celles et ceux qui n’étaient pas des bouches. L’histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on… et en l’occurrence, celle du monde est le livre d’histoire des blancs… des hommes blancs. Si le pouvoir que caricaturait les bouches étaient l’apanage d’une catégorie, c’était bien celle des hommes, blancs, hétéros, de culture chrétienne et bien installés dans la vie. Les autres étaient donc des hommes non blancs, des femmes, des personnes issu.e.s des minorités de genre, religieuses et plutôt habitué.e.s aux affres des fin de mois. Tous ceux et toutes celles perdues dans le monde solitaire de l’oncle Arthur. Bref, celleux qu’on définissaient comme des minorités, invisibilisées, mais qui étaient bien plus majoritaire que la minorité visible qui se définissait pourtant comme incarnation de la majorité silencieuse. L’homme blanc – seul sur son trône de faire, semblait crier à l’éternité de l’histoire « Je suis Dieu ! » et, regardant le reste de la population susurre « et mes fils trouvent le diable ».
Bien sûr il ne s’agissait que d’une esquisse à gros traits de rouge à lèvre des mécanismes de la métamorphose. L’aspect buccal des nouvelles stars gommait les différences inhérentes à chaque personnalités. Mais pour autant, les rares femmes spécialistes médiatiques étaient toujours moins bien payées que leurs homologues masculins. Et même si ça progressait, elles étaient encore trop souvent cantonnées à des spécialités associées à la féminité, ou plus exactement, elles n’avaient que très peu accès aux spécialités dites masculines. Et, lorsqu’elles parvenaient à s’imposer dans un débat d’hommes, leurs positionnements étaient raillés, hystérisés ou systématiquement coupés. De même dans le journalisme, où il y avait bien peu de bouches féminines pour commenter un match de foot ou de tennis. Les racisés étaient toujours moins bien représentés parmi les journalistes que dans la société. Et là aussi, malgré quelques timides avancées, ils étaient souvent assignés à la couvertures d’émeutes urbaines et autres poncifs sur les banlieues difficiles. Les rédacteurs en chef utilisaient toujours leur couleur de peau comme un sésame pour passer le périph’ parisien ou pour comprendre le rap.
Après quelques cafés, un paquet de clopes, les quatre amis délaissèrent les places assises de la terrasse pour dégourdir leurs jambes en parcourant les allées du marché. Ils achetèrent de quoi préparer une belle grosse salade à partager, du pain, du fromage et quelques beaux morceaux de barbaque à faire à la plancha. César avait demandé à sa femme de les rejoindre pour midi. Les copines de Jack étaient partis entre-elles pour le week-end et Cat était un célibataire heureux. Notre homme savait que Virginia les rejoindrait pour le déjeuner. Elle avait prévu de squatter la cour de l’immeuble pour quelques découpes de bois.
Ils décidèrent d’aller jeter un œil. Notre homme prit Virginia dans ses bras, l’embrassa et lui glissa quelques mots à l’oreille. Ils arrivaient au bas des marches qui montent vers la République lorsqu’ils entendirent s’élever du muret une voix vociférante. Notre homme reconnut immédiatement l’uniforme d’un policier municipal. Il était de dos et sa gueulante faisait s’égailler une dizaine de punks à chiens maugréant qui, sans le regarder, ni même vraiment l’écouter, ramassèrent mousses et molosses et prirent leur cliques et leurs claques. Lorsque le groupe mené par Virginia et notre homme croisa le policier, celui-ci se retourna. Sous sa casquette le flic n’avait effectivement plus de tête, juste une gueule encore écumante d’avoir exercé son autorité toute républic’haine. Le flic les regarda, bien qu’il n’eut pas d’yeux. Mais quelque chose aux commissures de son sourire sardonique bordé d’une fine barbe cramoisie semblait les fixer. La lune, descendant vers d’autres latitudes, regardait en-bas et riait. Le jour des âges advenait.
FLOODLAND – The Sisters Of Mercy, 1987

César, Jack, Cat, Virginia et notre homme restèrent cois devant la grande gueule en uniforme. Les bouches passaient de l’autre côté des noirs miroirs. Et il n’y avait nul lapin blanc pour les guider. C’est Virginia qui tira les quatre mecs de l’inertie provoqué par la vision cauchemardesque du flic à grande gueule. Ils reprirent leur marche d’un pas lent et passèrent devant le flic, évitant de lui lancer le moindre regard, ni direct, ni de travers.
Le retour vers l’appart de notre homme se fit dans le silence. Un silence encore plombé par la stupéfaction. Un silence où l’on pouvait entendre les cellules grisées par cette essence nouvelle mettre en marche leurs méninges. Un silence lourd et pesant, assourdissant. Un silence qui ne savait pas encore quoi dire. Une fois la petite troupe posée chez lui, le silence explosa en mille questions. Bien sûr, iels avaient été surpris de voir ces lèvres gigantesques s’agiter entre l’uniforme et la casquette du keuf, IRL, dans la vraie vie, hors des écrans. Bien sûr, ça changeait pas mal de choses. Le petit reste auquel leur esprits rationnels s’agrippaient encore, cette infime possibilité que ce soit le média, les écrans quels qu’ils soient, qui fut l’origine de la métamorphose venait de se dissoudre dans la réalité brute. Bien sûr, iels avaient évoqué cette possibilité en posant comme responsable de l’hallucination leur propre cerveau. Bien sûr, l’idée que les gens d’armes puissent eux aussi se transformer, étant l’instrument de la domination, étant ceux qui donnaient corps aux lois, qui faisaient tomber les coups de la loi, n’était pas absurde. Et pourtant, la sidération engourdissait encore leurs membres et leur esprit. L’abîme qui s’ouvrait sous leurs yeux faisait tomber l’empire de leurs sens. La terre était inondé de mensonges et le monde sombrait dans la folie. Iels avançaient sur un terrain meuble qui s’évanouissait sous leurs pas, sans plus de repères que ceux qu’elleux-mêmes poseraient. Iels étaient tels des flocons de neige poussés par le vent de la corruption. La sensation de vertige était saisissante.
Tout en cuisinant, le petit groupe affinait sa réflexion, découpant les faits comme les poivrons, lavant les chapitres de cette drôle d’histoire comme les bonnes feuilles de la salade, éminçant les observations tel du blanc de poulet, débitant quelques analyses grossières comme iels coupaient grossièrement le bœuf ou les oignons, faisant revenir quelques spéculations délaissées en même temps que les lardons. Iels firent macérer quelques idées farfelues dans une sauce coco, citron, piments. Iels assaisonnèrent de sel de poivre et de quelques pincées de pensées piquantes. Bientôt les feuilles vertes trônaient dans le saladier, la viande grillait au-dessus des braises. La table était dressée. Lucrèce, la femme de César, avait appelé, elle arriverait pour le dessert. Les ami.e.s servirent les légumes braisés, disséquèrent la chaire grillée et leurs pistes de raisonnement, accompagnèrent tout cela de quelques pensées plus légères. Iels avaient beau tourner et retourner toutes ces salades, aucun sens ne se dégageait explicitement. Ils avaient bien plus de mal à avaler cette métamorphose dont iels étaient les témoins qu’iels n’en auraient à digérer leur repas.
Lorsque les plats furent vidés et les estomacs remplis, la discussion prit une tournure plus apaisée. Les sentiments contradictoires qu’iels éprouvaient formaient comme la mousse onctueuse et amère des cafés et donnaient aux fumerolles des cigarettes une âcreté prononcée. Toustes avaient été surpris de voir la métamorphose toucher un simple flic, pas une grande gueule de la télé, bien qu’iels s’y soient attendu. Iels avaient (sans vraiment la formuler) émis l’hypothèse que les médias ne soient pas le vecteur de la transformation, que ce soit le pouvoir symbolique et que par conséquent, il n’y avait aucune raison valable pour que le phénomène ne se limite aux écrans. L’idée que leur filtre d’analyse du monde soit ce qui en transforme leur vision revenait de plus en plus dans la discussion, comme une arme à double tranchant. D’un côté, iels se sentaient perdre la raison, débordé.e.s par le sentiment d’être responsables de ce cauchemar et d’un autre y voyaient une planche de salut. Iels avaient le pouvoir de rendre explicite la domination, de lui donner corps… ou plutôt bouche. On sonna à la porte puis on tambourina. Notre homme se leva et alla ouvrir. C’était Lucrèce, mais son visage était déformé par un mélange de stupéfaction, de colère et de peur. « Toi, t’as vu une bouche IRL... », suggéra notre homme. « On sait, on en a vu une en revenant du marché. On était, et sans doute qu’on l’est encore, dans le même état que toi. Mais vient, entre. » « No… non. Pas une bouche » fit Lucrèce en franchissant le seuil. Elle reprit son souffle en traversant le couloir qui menait à la cour où la troupe était installée. « C’est pas une bouche géante que je viens de voir dans la rue. C’est… une énorme oreille ! »
Les yeux de César, Jack, Cat, Virginia et notre homme étaient aussi rond de stupéfaction que leur bouche béantes. Notre homme failli défaillir et du s’asseoir avant même d’avoir proposé une chaise à Lucrèce, qui en prit une toute seule. Elle tremblait et césar la prit par les épaules et lui offrit un très large sourire plein d’une compassion un peu trop paternaliste. Puis, il lui frotta le dos comme pour la réchauffer, bien que le soleil fut du même plomb que le silence qui s’installa. Virginia prit les mains de Lucrèce. Elles étaient glacées. Et, lui tendant l’oreille, elle lui demanda de raconter ce qui s’était passé. Des larmes roulèrent sur les joues de Lucrèce qui hoqueta et commença à s’épancher. « Je venais de… J’étais en voiture. Je roulais tranquillement et je me suis arrêté à un feu. Il y avait la musique et je regardais à droite et à gauche en chantonnant. Il y avait une camionnette, vous savez, le plombier, celui qui dit « Eau près de chez vous depuis 1959 ». Et là, il y avait un homme… enfin deux mais je n’en voyais qu’un seul, l’autre était caché par la porte de la camionnette. L’homme que je voyais… son visage se décomposait. Il rentrait la tête dans les épaules, comme un enfant qu’on gronde. Malgré la musique j’ai commencé à entendre des mots forts, criés, sûrement par l’autre homme, celui qui était derrière le camion. J’ai baissé la vitre, prête à intervenir, parce qu’on n’a pas le droit de gueuler comme ça sur quelqu’un. Mais le visage de l’homme… il a commencé à disparaître. Comme si il y avait une ligne de partage des os, qui courait du sommet de crâne jusqu’au menton. Et le visage s’engouffrait dans cette faille. D’abord j’ai cru que c’était le soleil qui m’éblouissait et obscurcissait le visage du mec, mais non, parce que très vite, il ne restait plus entre le col de son t-shirt et le bonnet qu’il portait, que ses oreilles. Ses oreilles qui grandissaient au fur et à mesure, comme si la soufflante de l’autre gonflait ses pavillons. C’est la voiture derrière moi qui m’a sorti de ma torpeur. Le gars klaxonnait car le feu était vert. J’ai démarré et le feu passa à l’orange puis au rouge, mais le gars derrière moi me grilla la priorité et le feu. Quand il a été à ma hauteur il gueulait tout seul dans son gros 4x4 en me regardant. « Pauv’ conne. Ah les gonzesses au volant, j’vous jure ! » Lui, son visage avait commencé à se déformer sous le coup de sa colère machiste. Je l’ai vu dans le rétro. Et quand il est passé à côté de moi, son visage n’était plus qu’une bouche. Mais pas une de ces grandes gueules de la télé, une bouche à peine plus grande que la moyenne, mais juste une bouche, la bave aux lèvres. Je lui ai fait un doigt en gueulant « ta gueule ! » et il a accéléré et moi je me suis arrêté. J’ai regardé derrière pour voir si je voyais encore le gars aux grandes oreilles. Mais non, la camionnette était en train de partir dans l’autre sens. Et je suis venue. » Il y eut un nouveau silence. « J’en peux plus de ces machos et leurs grandes gueules ! On peut pas sortir sans qu’un abrutis nous fasse sentir qu’il est l’homme, et que nous, pauvre femme, on est rien ! » Elle fit une pause et demanda. « Est-ce que nous aussi, on va se transformer ? Et les enfants aussi ? » Submergée par le flot de larmes, les traits de ses émotions contradictoires formaient comme des îlots asséchés sur son visage.
Personne n’avait de réponse… et toustes se rendirent compte qu’iels n’avaient à aucun moment envisagé leur propre transformation. Biens sûr, les quatre garçons remplissaient pas mal des critères qu’ils avaient associés aux tenants de ce pouvoir symbolique associés à la métamorphose… Ils étaient des hommes, des quadras, blancs, de culture chrétienne (même si ils se définissaient comme athés), cis-hétéro (même si certains avaient pu expérimenter quelques relations homo). Certes, aucun d’eux ne gagnait outrageusement sa vie, l’un ou l’autre n’était même pas vraiment sorti d’une certaine forme de précarité, mais aucun d’eux ne vivait dans la misère et deux d’entre eux étaient même propriétaires. Une petite maison pour César et un appart’ en ville pour Jack, dont ni l’un ni l’autre ne finissait de rembourser le prêt.
« Lucrèce, mon reflet, ma sœur… moi aussi j’en ai marre de ces agressions quotidienne, de ne pas pouvoir m’habiller comme je le veux sans me demander si je n’aurai pas trop l’air d’une proie aux yeux de mecs prédateurs, de cette masculinité toxique, de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans avoir l’impression d’être un bout de bidoche sur l’étale d’un boucher, de ce sexisme ambiant qui donne aux mecs leurs grandes gueules. Il faut que ça cesse ! » déversa Virginia. Elle fit une pause dans un silence sec. Puis elle reprit : « Finalement ça se tient… J’veux dire, qui dit bouche, entend oreille. Qui dit oreille, entend bouche. Et puis un pouvoir, même symbolique, s’exerce sur l’Autre. Si le masque du pouvoir est une bouche, l’Autre devait être une oreille. » Formulé ainsi, ça prenait sens. C’était grotesque, mais sensé. Dur à avaler, mais digeste. Virginia continua : « Visiblement, les transformation commence à se répandre. Après les rois de la com’ et les flics, les machos se transforment aussi en bouches. Par contre, si toutes celles et tous ceux qui entendent ces grandes gueules déverser leur flux de conneries doivent se transformer en oreilles, il va y avoir une véritable épidémie. À commencé par les femmes ! » Lucrèce demanda : « Pourquoi je ne me suis pas transformer en oreille, quand l’autre type m’a gueulé dessus ? » « Je ne sais pas. Peut-être parce que tu as réagi ? Peut-être que l’une des caractéristiques pour se transformer en oreille, c’est de se laisser faire ? »
Notre homme posa le gâteau sur la table et Jack plaqua une sentence : « Vous avez remarqué que certaines des suggestions qu’on a formulé la nuit dernière se sont réalisé… Comme dans l’idée de César, quand il a parlé de notre façon de voir qui transformait le monde. Si c’est en train d’arriver, comme le disait Cat, on peut infecter les gens avec nos visions et espérer une révolution. » « Tu sais, c’est très théorique, juste une idée… commença Cat. Et puis, on a pas la puissance médiatique pour que notre façon de voir transforme le monde. » « Par contre, vous avez un ego bien démesuré les gars ! Lâcha Virginia. Non mais vous vous entendez ? Vous pensez sérieusement que vous êtes à l’origine de la métamorphose de milliers de bouches ? Sans parler des centaines de millions d’oreilles à venir ? Que votre image du monde, née dans vos petits cerveaux pourrait avoir changer le président en grande et belle gueule ? Sérieux ? Vous êtes bien des mecs ! Redescendez ! Vous me faites chier avec vos grandes idées, vos grands discours et vos débats théoriques qui n’en finissent pas… alors que c’est la réalité, la pratique et celles et ceux qui la mènent qui tranchent. Mettez les mains dans le cambouis. Si vous pensez sérieusement que vous pourriez infecter le monde de votre image mentale, commencez par déconstruire les préjugés qui la hante au quotidien et commencez par construire des solidarités ici et maintenant. » « Mais on ne sait même pas ce qu’on a en face de nous. Est-ce que les gens se transforment vraiment ? On en sait rien ! Tout est peut-être dans nos têtes. Pour réagir, il faut bien qu’on ai une idée de ce contre quoi on se bat », affirma Jack. « Et là, c’est bien la réalité qu’on essaye de décrypter », renchérit César. « Tu veux qu’on fasse quoi ? Qu’on organise des groupes de paroles pour celles et ceux qui se transforment ? Pour les bouches ? Pour les oreilles ? Pour les deux ? » Elle les fixa et répondit : « Ok. Si les gens se transforment, visiblement ça ne change pas grand-chose à ce qu’on connaissait déjà comme situation. Les dominants se transforment en bouches et les dominés en oreilles. Est-ce que ça change fondamentalement les choses ? » « Elle a raison. Intervint Cat. De toute façon, nous n’avons pas les moyens de savoir ce qui a déclenché ces transformations. Ce n’est pas contre ces transformation qu’on doit se battre mais contre ce qu’elles symbolisent. » « Ouais, sauf que les gens se transforment, c’est pas le Pays Imaginaire ! insista César, Nous allons peut-être nous métamorphoser nous aussi. » « C’est vrai, intervint Lucrèce. T’as envie d’être changé en oreilles, ou en bouche ? Moi j’ai pas envie, pas plus que de voir mes gamins n’être que l’une ou l’autre. Et pour l’empêcher, si c’est possible, il va bien falloir qu’on comprenne ce qui se passe. Non ? » « Même si on comprend, est-ce qu’on est à même de changer le cours des choses ? On pourrait faire un parallèle avec l’apparition du Sida. Est-ce que ce sont les gens touché.e.s qui ont pu comprendre cette nouvelle maladie ? Qui ont pu trouver des médicaments ? Non, par contre en s’organisant, iels ont pu influer sur la recherche, pour que les malades soient pris en compte, vraiment. Iels ont organisé la solidarité autour des malades. » répliqua notre homme. « Ouais, mais on ne sait pas si c’est une maladie. Je sais que vous allez encore me traiter de complotistes, mais si ça se trouve c’est un truc que nous ont inoculé les puissants. » Les voix déferlèrent par vagues, se fracassant les unes contre les autres, un véritable déluge de mots trop hauts ; la raison faisait naufrage dans ce brouhaha générale dont la sonnerie du téléphone tira notre homme. « Oh, stop ! Arrêtez ! » Toustes se tournèrent vers lui. « Je crois qu’on devrait écouter les infos. Il se passe un truc. »
KILLING JOKE – Killing Joke, 1980

Virginia alla chercher l’ordi, ouvrit la page de FranceInfo et lança le direct radio. Plage météo. « C’était qui au téléphone ? » demanda-t-elle ? « C’était Rv. » « Et ? » « Chut, ça commence... » fit Cat. Le jingle d’intro du journal fut suivi des voix graves d’un duo de journalistes stars (rien qu’à la voix, la petite troupe les imaginait tout sourire – littéralement ! C’est pour ça qu’ils avaient préféré la radio à la télé) : « FranceInfo, il est 17h. Bienvenus si vous nous rejoignez. Tout de suite, les titres. » « Ce journal sera entièrement consacré à la vague de mutation ou d’hallucination collective qui touche notre pays. Nous reviendront en toute fin de journal sur la nouvelle désillusion du PSG en ligue des champions. » « Le président vient donc de faire une déclaration dans laquelle il a donné les premières explications amenées par les scientifiques et les premières mesures face à cette situation inédite. Je vous rappelle qu’il y a une heure à peine, le gouvernement avait émis un communiqué concernant les transformations de nos concitoyens en bouches et en oreilles. » « Oui, mais face aux divers aspects de cette crise inédite, le chef de l’État devait réagir et s’adresser aux français qui commençaient à trouver le silence du président troublant... »
Le président, d’un ton solennel avait déclaré la guerre. À qui ? Ni lui, ni personne au gouvernement, ni même le patronat, encore moins les corps intermédiaires et surtout pas la population, ne le savait vraiment. Le président avait évoqué tour à tour la première phase d’une offensive lancée par un pays ennemis… sans pouvoir le désigner. Une attaque terroriste sans précédent. La frappe d’un agent pathogène aux propriété psycho-active. Car le président le martela – moins que le mot « guerre » mais quand même – personne ne se transformait réellement. Il s’agissait d’un virus, d’une bactéreie porteur d’une molécule provoquant des hallucinations. Les services de santé tentaient d’établir si le pathogène était naturel ou s’il s’agissait d’une arme biologique, et son mode de transmission. Les services de renseignement se renseignaient afin de déterminer où il était apparu et cherchaient à déterminer le patient zéro.
Le président avait également évoqué des troubles provoqués par les hallucinations : émeutes, pillages, saccages et chasse à celles et ceux qui apparaissaient aux autres comme bouches ou oreilles. Face à la situation, le président avait annoncé des mesures radicales : confinement général de la population, fermeture des établissement scolaires et de ceux accueillant du public, des commerces non essentiels. Interdiction des déplacements et des réunions. Le télétravail devenait la règle. Plus surprenant, l’arme étant biologique, il décréta l’interdiction de la vente et de l’achat de produits issues de l’agriculture biologique, évoquant les seuls produits de l’industrie l’agro-alimentaire comme garant de sécurité sanitaire. Les produits de premières nécessités seraient livrés aux consommateurs. Les rendez-vous médicaux se feraient par visioconférence. Seuls les services de santé, de sécurité continueraient de fonctionner presque normalement. Bref, il avait décidé l’arrêt presque total de l’économie du pays. Bien sûr, ces mesures exceptionnelles en temps de paix – ce qui contrastait avec son discours martial – étaient provisoires et n’avaient pour but que de protéger le peuple dont il était le président. L’armée et les services de sécurité étaient placés en état d’alerte et quadrilleraient aussi bien les villes que les axes routiers. Dans les jours à venir, le premier ministre et les ministres concernés donneraient tous les détails concernant la mise en place de ces mesures, ainsi que les aides financières exceptionnelles qui seraient débloqués pour soutenir les entreprises touchées par l’arrêt de l’économie, ainsi que les ménages privés de ressources. Le chef de l’État entonnait le requiem d’une démocratie toujours moins représentative. Amen !
La petite troupe réunie chez notre homme resta bouche bée une fois de plus. Quelque part, iels étaient soulagé.e.s de savoir que l’hallucination touchait au-delà de leur petit collectif. Que les visions soient provoquées par un agent extérieur leur ôtait le poids de la folie. Comme iels en avaient fait le constat, iels n’avaient pas les connaissances, ni les possibilités expérimentales, pour déterminer les causes de ces métaphormoses. Par contre, iels étaient terrassé.e.s par l’autoritarisme dont faisait étalage le président. Le peuple n’était pour lui que le troupeau dont il était le berger. Quant au chien dudit berger, on voyait bien qui en endossait la peau… de vache.
Face à la verticalité du « pouvoir sur », iels décidèrent de mette en branle le « pouvoir de » de l’horizontalité. Le changement de paradigme qu’iels voyaient poindre sur la nouvelle ligne de front nécessitait une réponse forte, la mise en place d’une guérilla sociale, d’une auto-défense populaire. Iels tinrent un conseil de résistance au rythme d’une danse de guerre. Il leur fallait rester en contact tout au long de la crise. Le confinement n’allait pas faciliter les choses. Lucrèce et César devaient rentrer pour s’occuper de leurs enfants. Par contre Jack et Cat décidèrent d’occuper l’un des appart’ vide du petit immeuble de notre homme. Virginia accepta de s’installer chez notre homme. Afin d’échanger avec César et Lucrèce, le collectif choisit d’utiliser en priorité une appli qui transformait leurs téléphones portables en talkie-walkie. Pour se faire passer des documents, iels privilégieraient Wire, tout en effaçant les messages toute les 24h. La virtualisation forcée par la crise mettaient sous la coupe des Gafam presque toute forme de correspondance électronique. Il fallait dores et déjà préparer le monde de demain. Un monde de contrôle permanent. Un monde d’attente perpétuel. Un monde primitif en mode haute technologie.
Iels se répartirent certaines tâches afin de garder leur esprit critique. Cat et Jack furent désignés pour éplucher le web à la recherche des données officielles, du consensus scientifique qui s’imposerait, mais aussi de prêter l’oreille aux voix dissidentes sur le sujet et d’en évaluer la pertinence. César et Virginia devaient réfléchir à des actions de solidarité et de santé communautaire à mettre en place. Pour ça, iels chercheraient sur les réseaux sociaux les échos de tels solutions pratiquées ailleurs et d’évaluer la faisabilité par le collectif et d’essayer de se coordonner avec d’autres groupes actifs dans la ville. Enfin, Lucrèce et notre homme devaient bosser sur une autre explication au phénomène des métaphormoses. Le petit groupe avait relevé que le président n’avait pas fait mention de la distribution non aléatoire des métamorphoses. Les bouches symbolisaient bien un pouvoir et les oreilles une position de soumission, iels en étaient sûr.e.s. Iels étaient donc chargé de vérifier qu’avec la massification des transformations le phénomène se vérifiait encore. Iels devaient également chercher un moyen de vérifier que les métamorphoses n’était réellement que des visions. Le président avait tellement insisté sur l’irréalité du phénomène que ça en devenait suspect aux oreille de nos amis. Trois réunions hebdomadaire étaient prévues, une pour chaque groupe de travail. Enfin, et parallèlement à leurs tâches respectives, tous et toutes se retrouveraient en visio une fois par semaine pour voir si ils, elles, ne mutaient pas.
Paradoxalement, l’intervention du chef de l’État les avait sorti de la léthargie et les poussait à monter au front. Les complications que cette guerre de basse intensité faisaient naître leur redonnait l’envie de faire par eux-mêmes. Iels donnèrent un nom à leur collectif. Un nom pas trop repérable sur les réseaux, mais y glissèrent une référence à la fois à l’Espagne libertaire et à Killing Joke : « S.O. 36 ».
Cat et Jack firent remonter rapidement le consensus scientifique qui semblait s’imposer. Comme l’avait répété le président, personne ne se transformait réellement. Il semblait en effet s’agir d’une illusion provoquée par un agent psycho-actif. C’était la frontière entre le consensus et le dissensus. Si la majorité des chercheurs estimaient que l’hallucination était provoquée par un agent extérieur, aucun labo n’était pour l’instant parvenu à isoler le virus, la bactérie ou la molécule responsable. À partir de ce point courait une ligne de front avec des théories moins scientifiques et plus complotistes. On citait alors, en dehors d’une attaque terroriste ou d’une puissance étrangère, une arme expérimentale de l’armée, la fuite d’un virus d’un labo, les effets de la 5G, l’explosion d’une centrale nucléaire cachée par le gouvernement, les prémices d’une invasions extra-terrestre, etc, etc. Parmi ces théories capillotractées, Jack en avait trouvé qui remettaient en cause le caractère illusoire de la métamorphose. Pour ces partisans, il s’agissait bel et bien de transformations physiques dues à une mutation génétique provoquée au choix, et là aussi, par les antennes relais téléphoniques de nouvelles générations, une fuite dans une centrale EPR. Bref tout l’éventail des théories évoquées plus haut mais adaptées à la mutation de l’ADN. Les hostilités étaient lancées.
Le travail de Jack et Cat renforçait l’idée du groupe sur l’aspect hallucinatoire du phénomène mais les laissait toujours sans certitudes quant à sa cause. Iels décidèrent pour l’instant, au vu de ce que rapportaient Lucrèce et notre homme, que les métamorphoses n’étaient pas aléatoires mais caractérisaient bien la distribution d’un certain pouvoir.
César et Virginia avaient sans doute la recherche la plus enthousiasmante. Remonter les différentes initiatives mises en place pour soutenir les personnes touchées par la crise métaphorique. Des centres sociaux, des squats offraient aux personnes victimes d’hallucinations des espaces de repos, une prise en charge des enfants, faisaient leurs courses, gérer le parcours administratifs pour leur permettre de bénéficier des aides au télétravail ou au chômage partiel. Des centres de santé communautaires se mettaient en place afin d’accueillir les cibles de lynchages (ce nouveau sport sanguinaire engendré par l’état de guerre d’un temps de paix forcée) car ayant été vues comme oreille, et même quelques bouches. Ils accueillaient également les victimes d’hallucination et tentaient d’atténuer leurs maux par différentes approches médicales et para-médicales.
La solidarité s’exprimait également dans la mutualisation de certaines ressources et la désobéissance vis à vis des consignes gouvernementales concernant l’interdiction du bio. C’est le combat que choisirent de mener le collectif. Virginia et César proposèrent d’agrandir le potager de l’immeuble de notre homme en y ajoutant la cour et d’autres espaces communs. Le surplus produit serait distribué aux habitants du quartiers. Le collectif décida également de préparer des repas et de les livrer aux personnes dépendantes des quelques rues bordant l’immeuble. Ils mirent en place également des ateliers pour apprendre à communiquer de façon sécurisé, de familiariser leurs voisins au cryptage, au VPN, à TOR. Quelques jours plus tard, après avoir évalué les besoins qui remontaient des habitants du quartier, le petit groupe mis en place un système de garde d’enfants, afin de soulager les mères célibataires et les parents en burn-out. De leur côté, César et Lucrèce, partagèrent une partie des produits de leur jardin, et organisèrent des cours et de l’aide aux devoirs dans leur village et par visio pour les enfants accueillis par la garderie du collectif.
Au-delà des tâches qu’iels s’étaient assigné, toustes se demandaient s’iels seraient bouche ou oreille aux yeux des autres. Notre homme se souvenait qu’ado, avant d’être une voix de la radio, il avait été une oreille attentive. Que c’est ce plaisir de la découverte de musique, de films, de tout ce qui pouvait passer à sa portée, et plus encore le plaisir de partager ça, ce plaisir d’écouter l’autre vous passer sa passion, c’était toute ces heures d’écoute qui lui avait donné ensuite envie de donner de la voix, de transmettre son enthousiasme, d’être le porte-voix d’êtres singuliers. Et dans ses émissions, aussi loin que leurs débats endiablés pouvaient les mener, il avait toujours eu l’impression de faire ça pour les auditeurs solitaires et les filles en bande, pour les potes qui se retrouvaient pour écouter la retransmission d’un concert ensemble, comme d’autres se retrouvaient autour d’un match de foot en live dans le bar du coin de la rue. Quand ils interviewaient une sociologue à propos de musique, lorsqu’ils convoquaient les dits et écrits de Foucault ou Deleuze à la suite d’un morceau anti-carcéral des Bérurier Noir, qu’ils récitaient Maïakovski après avoir entendu « À l’arrière des taxis » de Noir Désir, sa voix n’était que la première oreille, celle qui avait le pouvoir de recueillir les dits de celles et ceux qui ont des choses à dire et de les porter jusqu’à d’autres esgourdes dont ils réchaufferaient les sens. Ceux qui savent écouter se révèlent parfois très doués pour faire parler les autres et transmettre cette parole.
Les oreilles, de ce qu’iels en voyaient, étaient des fonctionnaires que les élites jugeaient dysfonctionnels, des employé.e.s du secteur privé ou les privé.e.s d’emploi. C’était beaucoup de femmes, de racisé.e.s. C’était des infirmiers, des infirmières, qui rognaient leur vie dans d’interminables heures sup’. C’était des travailleuses et travailleurs sociaux qui devaient faire de la misère à laquelle ils, elles faisaient face une entreprise rentable et efficace. C’était des gars qui gravissaient chaque jour des chaînes de montage, sans en apercevoir jamais le sommet, mais qui chaque jour recommençaient sans jamais se démonter. C’était des filles qui ne voyaient du ruissellement promis que celui des beuveries des bouches, tous les vomis, la merde, la pisse et le foutre, que chaque jour avec une constance héroïque elles ramassaient dans le sillage des bouches ou à la traîne de certaines oreilles toujours à l’écoute des desiderata du patronat.
C’était ces profs, ces instit’ qui se consumaient d’année en année jusqu’au burn-out, au long d’heures de préparation non payées, ou payées par l’instit’ sur son temps tellement libre qu’il s’est envolé depuis fort longtemps. Une vie privée, sacrifiée sur l’autel de l’enseignement public jusqu’à en être privé de vie même, en tentant d’atteindre les objectifs inatteignables fixés par des politiques dont le but était de démolir le service public pour booster le marché privé. Un prêté pour un rendu entre preneurs. Un bouche à bouche sourd aux besoins des oreilles.
Les oreilles, c’était aussi des journalistes, des pigistes, des JRI, toutes celles et tous ceux qui ramènent les proies dont se repaissaient les bouches aux dents longues vues à la télé ou sur le net.
C’était les précaires, ces oreilles qu’on inonde d’ordres, de consignes, toutes celles et tous ceux qu’on a débarrassé de leur métier pour leur faire exécuter des protocoles, les définir en termes de compétences. Mais un métier, c’est plus qu’une simple collection de compétences, c’est vouloir donner du sens à ce qu’on fait. C’est, certes un savoir-faire, mais c’est aussi un faire-savoir.
La grande majorité des oreilles, semblaient ne rien entendre à rien, mais écoutaient. Elles obéissaient, acquiesçaient aux paroles des forts en gueule. Se levaient le matin pour participer à l’effort collectif, sans remettre en cause un objectif dont l’aspect collectif était fort discutable, surtout du point de vue des oreilles. Mais pourtant, celles-ci écoutaient tout, tout le temps. Les médias leur fournissaient la bande-son de leur vie, comme le clocher avaient rythmé la vie des campagnes, comme la sirène celle des usines, la cloche celle des écoles.
DEAD
CAN DANCE – Deand Can Dance, 1984
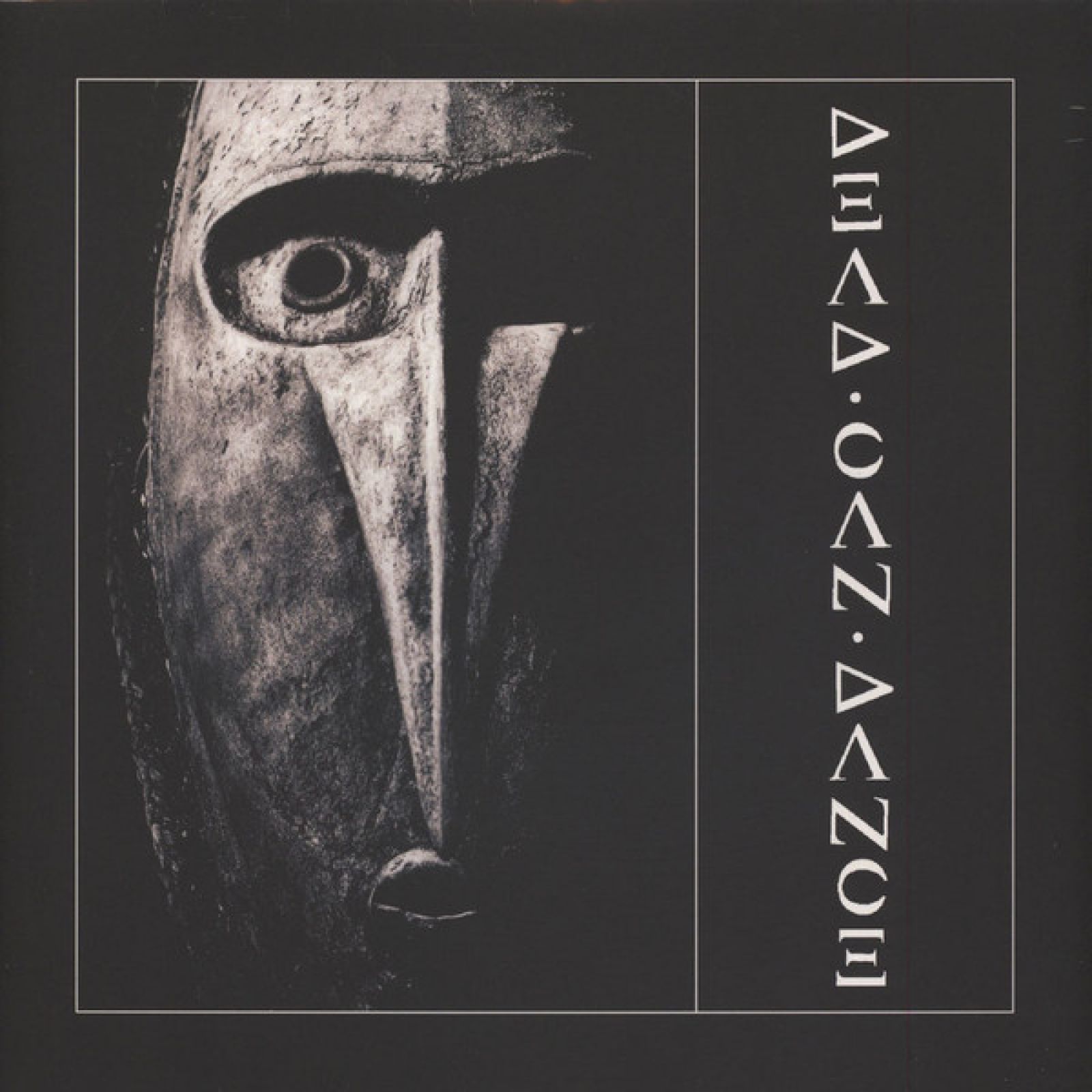
Alors que la métamorphose des bouches avait été rapide, comme une évidence, celle des oreilles fut plus progressive. Comme si les bouches avaient toujours étaient des bouches. Comme si elles n’avaient pas eu, il y a peu encore, un visage. Les bouches étaient là, tout d’un coup, comme de toujours. Tellement habituel que la métamorphose n’avait fait l’objet d’aucun commentaire.
Pour les oreilles, l’impact fatal avait commencé dans la foule anonyme des rues, dans le bourdonnement des start-up ou le ronronnement des grosses entreprises, dans la queue du super-marché, dans la cohue du bus ou le parcours kafkaïen d’une administration (combien de dialogue de sourds), petit à petit certains visages disparaissaient derrières des oreilles dont les pavillons s’étendaient à mesure que le flot ininterrompu de paroles insensées se déversaient dans ces siphons auditifs. C’était assez logique. Toutes ces voix médiatiques avaient besoin d’oreilles dans lesquelles se déverser pour être écoutées, regardées, likées, partagées, commentées. Le spectacle n’a pas tant besoin d’être compris, entendu, il se contente d’être écouté. Les oreilles, elles, incapables de formuler leur pensée, noyées sous toutes les voix qui tourbillonnaient tout autour d’elles, écoutaient. Elles s’exprimaient en choisissant ce qu’elles étaient prête à entendre. Mais aucune bouche n’aurait mérité qu’une oreille lui donne sa voix. Le monde que peignait tous ces discours ne correspondaient en rien à la réalité vécue par elles. Et les voix de la radio ne comprenaient pas la frontière qu’elles laissaient apparaître inconsciemment, entre la réalité des millions d’oreilles restées sans voix suite à la métamorphose et le cénacle des voix multi-médiatiques.
Ce n’est pas l’envie et moins encore le besoin de s’exprimer, qui manquait mais les oreilles étaient muettes. Et les rares fois où les bouches accordaient à l’une ou l’autre d’entre elles de s’épancher devant un micro, les pavillons auditifs se faisaient le simple écho de ce qu’elles avaient entendues des propres bouches. Les oreilles ne parvenaient pas à entrer en raisonnement avec les mots habituels dont les bouches les abreuvaient. Elles avaient beau copier, coller, mixer, démonter les discours, elles ne parvenaient pas à remonter le fil de leur impensé collectif et se bornaient à réfléchir les mots des autres. Pré-mâchées, les paroles des bouches ricochaient sur les pavillons, propageant la plus ou moins bonne parole d’oreilles en oreilles, parfois elles étaient aspirées par le cornet d’une oreille pour ne trouver qu’une boule de nerfs auditifs. D’autres fois des murmures entraient par une oreille et ressortaient par l’autre. Ou, une fois le seuil franchi, tombaient dans l’oreille d’un sourd. Le décalage était trop grand. Et l’un de ces mondes, celui des bouches, s’apprêtait à croquer, mâcher, mastiquer, avaler le monde entier, puis l’éructer en un rôt bien gras dans un grand éclat de rire. Cynique, niais ou franchement idiot ? Peut-être tout ça à la fois.
Le peuple des oreilles, cette foule immense, cette multitude qui s’agitait à la ville, se démenait à la campagne, qui en temps normal caracolait sur les trottoirs, trépignait aux urgences des hôpitaux, léchait les vitrines, sautait (sur) la case prison, servait dans les bars ou les restaurants, s’entassaient pare-choc contre pare-choc en files interminables… tous et toutes rangées dans des cases, des boîtes mobiles, individuelles ou collectives, qui les menaient de cages en cellules, de boîtes de nuit pour oublier en boîte de jour pour bosser à leur rédemption, emboîtées dans leurs maisons, de briques, de bois ou de simple carton. La vie comme une mise en boîte à perpétuité... jusqu’à la dernière !
C’est simple, les oreilles étaient partout ! Partout, sauf là où justement elles auraient dû être. Les diverses assemblées du pouvoir politique, sensés les représenter, ne comptaient que de rares oreilles parmi les élus. Dans les médias la situation était encore plus désespérante. Dans les films, les fictions, c’était toujours des bouches qui jouaient le rôle d’oreille. Les oreilles n’étaient jamais actrices, dans la fiction comme dans la réalité. Si certaines grandes oreilles avaient réussi à percer, à se faire entendre, elles devenaient des bouches. De verticales, les oreilles oscillaient et passaient à l’horizontale, les lobes se changeaient en lèvres, alors elles remuaient et retrouvaient de la voix.
Il y avait un autre genre d’oreilles. Elles semblaient ne jamais vraiment écouter, comme perdue dans leurs propre monde intérieur. Des oreilles renfermées. Fermées à tout dialogue. Mais entre les deux oreilles ça carburait. C’est entendu, elles avaient tout compris. Ces oreilles-là étaient parfois distraites, de celles où les vains mots tombent dans un gouffre auditif ; elles avaient la capacité de comprendre, d’imaginer et de concevoir. C’est elles qui parfois parvenaient à forger une parole neuve, en remettant cent fois sur le métier leur ouvrage fait de bribes de discours déjà entendus, des mots qui sont sur toutes les lèvres ou ceux restés sur le bout d’une langue. Jouant du marteau et de l’enclume, faisant rougeoyer les mots de l’émancipation, fondant un discours de révolution, corroyant la vision d’un monde nouveau, puis, faisant vibrer les tympans, elles parvenaient à faire résonner leurs idées dans les mots des autres et à les transmettre via leurs pavillons quasi-satelitaires. Ces oreilles, rares, avaient un grand besoin, pour élaborer leur propre pensée, des discours rapportés par d’autres. Elles devaient entendre les mots de la critique, une parole différente, des discours minoritaires. Ces oreilles faisaient, si on peut dire, la fine bouche. Elles choisissaient avec soin les mots qu’elles voulaient entendre afin de parfaire l’élaboration de leur pensée. Et pour ça, elles évitaient de tendre l’oreille vers la musique éternelle des grands médias, leur préférant le concert des voix alternatives, les auto-médias, toutes ces oreilles qui rapportaient la parole rare, les murmures de celles d’entre-elles qui ont quelque chose à dire, les maux de leurs sœurs de misère… La parole de sauvages des bois.
Écouter. Entendre. Voilà ce que font des oreilles. Elles écoutent attentivement ou entendent distraitement. Au sein du collectif, on discutait beaucoup ces notions. Écouter relever d’une volonté qui n’était pas aussi présente dans l’idée d’entendre. Mais entendre, avait fait remarqué Virginia, relevait aussi de la compréhension, sens qui ne se retrouvait pas dans l’idée d’écoute. Notre homme parla du rôle d’écoute chez les peuples zapatistes. L’oreille – homme ou femme - qui est là pour écouter et restituer ensuite dans les communautés. Mais ici, rien de semblable. Car écouter signifie surtout, dans le premier monde, obéir, donner raison à celui qui parle. Si les bouches ne pouvaient s’entendre entre elles, les oreilles se prêtaient souvent l’une à l’autre. Elles écoutaient ce que l’autre avait entendu, plus rarement une pensée singulière. Mais elles n’avaient pas conscience de la puissance qu’elles portaient en elles. Ici, l’écoute n’était pas valorisé. Et les oreilles conscientes d’elles-mêmes étaient peu nombreuses et pas vraiment organisées. Elles étaient seules au sein de cette multitude d’oreilles inconscientes de leur force collective.
Lucrèce, à force d’observer la métamorphose à l’œuvre, remarqua qu’une part non négligeable des oreilles jouaient les sourdes. Si comme on le dit, les murs peuvent parfois avoir des oreilles, certaines n’avaient entre elles qu’un mur épais d’incompréhension. Il n’y avait pas pire sourdes que celles-ci, qui refusaient d’écouter quoi que ce soit et voulaient surtout ne rien entendre. Elles en avaient assez entendues, des vertes et des pas mûres, de bien raides. Elles n’avaient que trop écouter. À force de surdité volontaire, elles étaient devenues aussi sourdes qu’elles n’avaient été rendues muettes.
Les sourdes oreilles et celles ayant la chance d’entendre avaient en commun de ne rien écouter. Pour le reste elles étaient aussi opposées qu’oreille droite et gauche. Elles se retrouvaient parfois dans la rue, rarement côté à côté, souvent face à face, cul pardessus tête dans la cohue de leurs sœurs qui, ayant écouté avec attention, ayant donné foi à ce qui avait été dit, demandaient des comptes, que les belles paroles se traduisent en actes. Les oreilles avaient toujours entendu le « nous » que toutes les bouches avaient aux lèvres comme un nous duquel elles faisaient partie. Elles se rendaient compte aujourd’hui que ce « nous » n’avait jamais concerné que les bouches. Elles ne parlaient jamais que pour elles. Et selon elles, les oreilles leur devaient leurs existences. Après tout les bouches ne donnaient-elles pas un sens à la vie des oreilles ? Que feraient les oreilles de leurs journées si elles ne pouvaient s’emplir de touts ces beaux discours ? Oh, bien sûr, il y avait des bouches aux propos plus progressistes, qui reconnaissaient volontiers que les leurs ne seraient rien sans le travail des oreilles. Mais même les bouches les plus ouvertes insistaient sur le fait que leur classe était celle qui générait la richesse de la communauté. Ce sont elles, les bouches, qui produisaient ce flot de mots sur lequel s’ébattaient grandes et petites oreilles.
Mais les oreilles repliées sur elles-mêmes ou retirées à l’est d’Eden, emmurées dans le silence, prenaient conscience (et faisaient prendre consciences aux autres oreilles) de leur force. Car plus les oreilles se fermaient et plus la production de discours, plus ou moins vains, s’accumulait, ne trouvant plus à s’écouler. Le flot s’assécherait peu à peu avec le marché réduit à peau de chagrin. La bulle discursive menaçait d’éclater et, si bien des oreilles prendraient à plein tympans l’onde de choc de la déflagration et en perdraient l’ouï. Les bouches craignaient de perdre bien plus que leur éloquence, leur statut, et de devenir de simples oreilles noyées dans un océan de silence. Certaines bouches, qui s’étaient extraite de leur condition première d’oreilles préféraient mourir plutôt que de retrouver la masse taiseuse. Les bouches ayant toujours été bouche n’imaginaient même pas perdre leur position. Elles ne connaissaient de la vie des oreilles que ce qu’elles en disaient. C’est à dire pas grand-chose. Les bouches ne pouvant entendre ce que disaient les oreilles. Elles ne pouvaient écouter l’autre qu’en bouche à bouche et ne pouvaient l’entendre qu’en lisant sur les lèvres.
Les bouches ne sentirent pas gronder le silence de la masse, cette vibration sourde qui sillonait la foule et faisait éclater les belles vitrines des discours consuméristes, des paroles publicitaires, les tours d’ivoire des promesses envolées, les cages de verre des mots d’ordre, des injonctions prêchées aux quatre vents, des sommations d’usage de la force.
Jack et Cat recensaient chaque jour ce qui se disaient des métamorphoses. Plus de la moitié de la population semblait touchée. Les services de renseignement sévissaient et renseignaient le gouvernement qui pourtant mentait sur la situation. Le président comme le premier ministres et les suivants ne distinguaient aucun sens dans la métaphore visuelle. Le seul axe de communication de ces forts en gueule était la recherche de l’origine de cette illusion collective. Pour les dirigeants, du public comme du privé, la métamorphose n’était en rien réelle, elle n’était qu’illusoire. Pour ces belles et grandes gueules, la transformation en bouches ou en oreilles étaient encore et toujours aléatoire et ne recouvrait en rien une quelconque logique à l’œuvre. C’était la ligne de défense qui reliait les discours des bouches, de droite à gauche, un sourire qui se voulait rassurant pour la population privée de parole. Pourtant, la métaphormose tenait lieu de procès. Elle mettait en exergue les lignes de fractures qui lacérait la société. Elle était un passage dans le temps, un trou de verre vers un monde exacerbé.
Les mensonges se multipliaient dans les bouches du pouvoir. Le gouvernement n’hésitait pas à proclamer des contre-vérités, tout en fustigeant les fake-news. Un ministre avait déclaré qu’aucun citoyen n’était insatisfait de l’actuel président. Un autre proclamait la réussite de son ministère niant par la même les propres chiffres de son cabinet. Les mots, en franchissant les lèvres perdaient maintenant leur sens. Les bouches avaient tant et tant tordu les mots dans tous les sens qu’ils n’en retrouveraient jamais l’initial. Les discours abscons des bouches avaient tellement connoté et déconnecté les mots qu’ils en étaient débarrassé de toute acceptation commune. Il n’était dès lors plus possible d’échanger, seulement de communiquer, de rapporter ce qui se faisait, ce qui se disait.
Virginia rappela la pensée de Hannah Arendt : « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »
THE SCREAM - Siouxsie And The Banshees, 1978
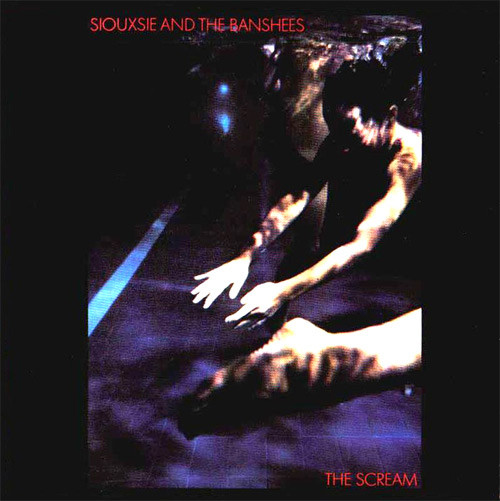
Depuis quelques jours, circulaient sur les réseaux sociaux des appels à manifester. Les remontées de César et Virginia coïncidaient avec ce que Lucrèce et notre homme avaient observé : un raz-le-bol des oreilles. L’élan de solidarité né en réactions aux mesures autoritaires du gouvernement trouvaient leurs limites. Le confinement isolait toujours plus les individus et il devenait de plus en plus difficile de distribuer de la nourriture ou de tenir les centres de soins communautaires. Le gouvernement avait décrété depuis quelques jours un couvre-feu qui limitait encore plus les déplacements. Les laisser-passer ne concernaient plus que les employé.e.s allant et venant sur leur lieu de travail ou quelques urgences médicales. Bien sûr, pour que cette nouvelle organisation sociale fonctionne, de très nombreuses personnes continuait de travailler et de croiser leurs congénères. Afin de limiter les risques de bagarres, les horaires étaient aménagés de telle manières à ce que les employés se croisent le moins possible, que l’autre devienne un mirage.
Les chercheurs avaient mis au point des sonotones qui réduisaient les effets visuels des hallucinations par suggestion hypnotique. Mais cela nécessité une technologie relativement coûteuse. Seul les personnels prioritaires – celles et ceux qui continuaient de travailler en présentiel – en étaient dotés, et en premier lieux les forces de l’ordre capitaliste. Le gouvernement espérait toujours trouver un remède efficace qu’il pourrait mettre en œuvre à grande échelle et à peu de frais. Malgré le coût pour l’économie – qu’il soutenait à grands coups d’argent magique (que certains assimilaient à une nouvelle façon de redistribuer les richesses) le président tenait le cap. Après tout, les entreprises les plus fortes sauraient s’adapter et survivraient, les autres… Ces mesures plongeaient à l’inverse un large pan des travailleureuses dans la précarité. Les salaires stagnaient puisque l’économie était à l’arrêt, mais les prix flambaient pour la même raison. Le travail se faisait un peu plus rare et toujours plus contraignant.
La situation devenait explosives et les théories les plus folles commençaient à courir sur les lèvres des bouches dissidentes. Le gouvernement avait provoqué ces hallucinations afin de mettre en place une nouvelle étape du capitalisme. Un capitalisme toujours plus prédateur, un capitalisme ayant perdu son visage humain. Un capitalisme pur, débarrassé de la carcasse sociale… l’équilibre le plus déséquilibré en faveur du gain, face à la nécessité de la reproduction de la force de travail. Un capitalisme du travail rare, le seul capable de faire face aux défis économiques que posait les changements climatiques. Ces grandes gueules de l’opposition appelaient à la désobéissance civiles et à manifester pour mettre fin au règne de l’actuel président, dépeint comme seul responsable de la crise et comme un dictateur en puissance. D’autres petites voix, des bouches plus minoritaires, parlaient de révolution et de mettre à bas le régime des « bouchois » pour faire advenir la dictature des prol’oreilles. À l’autre bout de l’échiquier politique, les grandes gueules appelaient au contraire à l’unité des bouches et des oreilles, à faire face ensemble à ce défi pour la nation. Ils rejoignaient le discours de la mise en place d’un nouveau capitalisme en y ajoutant une touche de racisme contre l’afflux toujours plus important d’immigrés qu’ils se gardaient bien évidemment de définir comme des oreilles, ne gardant que l’aspect étranger. En cela, ils tenaient le même discours que le gouvernement, en niant le caractère symbolique des métamorphoses. De leurs rang était également issu un mouvement anti-sonotones, qui y voyait une mesure discriminatoire et attentatoire à leur liberté. Basé sur la théorie que les mutations étaient réelles, ils expliquaient que les sonotones n’étaient réservées qu’aux seules oreilles et que c’était certainement pour les élites, les bouches, une manière de contrôler le peuple, de laver les cerveaux des honnêtes oreilles de souche. Tous et toutes avaient un point commun, le changement qu’ils proposait était immédiat : élection, grand soir, coup d’état, c’était comme actionner un commutateur. La lumière se faisait et le monde (re)devenait merveilleux.
Notre homme et ses ami.e.s discutèrent longuement de l’opportunité de rejoindre la mobilisation. Toustes tiraient le même constat des limites de l’auto-organisation des solidarité face au rouleau compresseur étatique. Jack et César, que le confinement minait plus que les autres, plaidaient pour rejoindre la mobilisation pour ne pas laisser la rue aux fachos. Virginia répliqua que dans le brouhaha de la foule, les oreilles n’entendraient que les mots d’ordre fascisant, étant donné que leurs réseaux étaient mieux structurés autour de quelques grandes gueules. Virginia et notre homme ne croyaient plus aux manifestations ni même à la spontanéité de l’émeute. Iels pensaient que ce n’étaient pas du chaos que pouvait naître une nouvelle organisation sociale, ni que les manifestations puissent être autre chose qu’une façon de quémander les miettes qui s’accumulaient aux commissures des lèvres des dirigeants. Sans un travail préalable, les vieux réflexes sexistes, classistes et racistes reprendraient le dessus dans la confusion de la foule. Lucrèce expliqua qu’on ne pouvait pas laisser la rue aux tendances autoritaires de tout bord sous peine de les voir triompher sans aucune opposition. Cat, quant à lui, pensait qu’il fallait s’y rendre pour observer et déterminer au plus près les rapports de force à l’œuvre au sein de la mobilisation. Iels avaient des sensations de puzzles : l’impression d’être en pièces et de tout faire pour recoller les morceaux ensemble. Après de longues palabres, la majorité étant pour se joindre à la manifestation, le collectif se prépara. Il fut décidé que temps que la manif serait pacifique, iels prendraient le pouls de la mobilisation. Si ça tournait à l’affrontement avec les forces de l’ordre, iels formeraient un black-bloc pour se protéger et protéger la portion de manif dans laquelle iels évolueraient. Enfin, dans la perspective d’affrontement avec l’extrême-droite, ils feraient bloc avec d’autres collectif pour les dégager de la manifestation.
C’est dans ce contexte explosif qu’ils répondirent à l’un des premiers appels à manifester. Si les syndicats de travailleureuses en étaient à l’origine, leurs mots d’ordre furent vite submergés par les slogans complotistes et autres thèses racistes. Pourtant, l’immense majorité des oreilles ne venait pas en réponse à un mot d’ordre. Non ! Les femmes, hommes, enfants, ces anciens et anciennes, qui n’étaient plus que de simples oreilles, menaçaient de disparaître sous les logorrhées plus ou moins indécentes mais toujours à flots continus, qui remplissaient des déversoirs auditifs comme on comble un trou, jusqu’à ce que les oreilles en aient par-dessus la tête… mais leurs ventres affamés, trous sans fin, ou d’une faim intarissable, commençaient à n’avoir plus même d’oreilles. Elles ne pouvaient se résoudre à disparaître et puisqu’elles ne pouvaient prendre la parole, les oreilles prirent la rue.
Une foule folle furieuse fluait tel un fleuve sortant de son lit. Les oreilles faisaient surface depuis les bouches de métro, se répandaient comme le trop plein orageux depuis les bouches d’égout. Le débordement se manifestait. La manifestation devait outrepasser le cadre imposé. Les oreilles étaient fermées, bouchées et ne renvoyaient plus qu’un silence sourd à toutes ces bouches bées qui les observaient. Le poids des mots écrasait habituellement tous ces silences gênés, ces soupirs intimes, l’agonie des non-dits et le râle des ouï-dires qui partout à présent couraient dans les artères des villes, étreignaient les avenues, balayaient rues et venelles. Le collectif se sentait grisé par la sensation de puissance de la masse. Iels étaient entraîné.e.s sur un toboggan en spirale… vers la bas. Mais il y avait tant de non-dits, trop de silences accumulés, de soupirs cumulés, tout cet air non brassé en était pesant, à force de ne pas vibrer, il devenait assourdissant. Paradoxalement, bien que ce silence fut asphyxiant, il n’en était pas moins une respiration, comme celle du corps ramené à la vie, un hoquet, une manière de gueuler le manque d’air ou d’en dégueuler le trop plein. C’était le souffle muet d’une explosion, celle d’une colère trop longtemps tue. L’inspiration et l’expiration du silence recouvraient tous les bruissements de la villes, faisaient des croques-en-bouches aux bruits qui courent. Le silence était déchaîné. On ne s’écoutaient plus et ça commençait à s’entendre dans ce silence assourdissant ! Ce cri muet rendait sourd, empêchant d’avoir quoi que ce soit à entendre. Il n’y avait rien d’autre à faire que de l’écouter et participer ainsi du silence. Une expérience quasi-mystique. On n’entendait même pas une mouche voler. Pas plus qu’on entendait une bouche soliloquer… Non que les bouches aient cessé de faire du bruit en remuant leurs lèvres, mais tout comme les mouches ne volaient pas, les bouches se turent. Tout simplement. Devant ce silence immense qui soufflait les fenêtres et les plafonds de verre, par centaines de milliers de soupirs, autant de pavés jetés dans les vitrines criardes des grands magasins, les tristes vitres des banques, le vitrage des commissariats et les glaces des palais. Les lèvres tremblaient et faisaient donner leur voix armée à grand renfort de grenades assourdissantes, de bouches à feu ou à eau, des canons à ultrasons, c’était un combat dantesque, tel que celui qui oppose de toute éternité les ténèbres et la lumière. Chacun voyant midi à sa porte et minuit à celle de son ennemi. Les images criardes se succédaient, telle une série de cartes postales en métal.
Mais si les bouches, comme les oreilles, avaient conservé leurs corps, ce qui leur manquait se situait plutôt en amont de leur débit de paroles et était censé ne pas se laisser dépasser par les mots. Cette petite chose qui fait qu’on tourne sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Le silence assourdissant les figèrent un instant sans voix, et même le roi – oui le président n’était qu’un roi élu – en resta coi. Les grandes gueules, les fines bouches, les caverneuses, les haut-perchées, les grosses et les petites, et celles qui demeuraient closes pour rester belle... toutes les bouches étaient aphones. Le souffle de l’explosion sourde et muette retomba, le silence se dissipait ça et là et une croûte de silence recouvrit tout, aussi loin qu’on pouvait voir. Bien qu’il y eut encore de très nombreux point de concrétion d’oreilles, déjà les premières voix se faisaient entendre, perçant la couche de silence fossilisé dans l’instant, la gueule enfarinée et la bouche en cœur les commentateurs recommençaient à commenter. Les bouches incendiaires reprenaient leur office quand d’autres langues pendantes léchaient les pieds des porte-paroles gouvernementaux, minimisant le souffle de la révolte tout en n’en exagérant la portée destructrice. La police vous parle encore et toujours à 20h… et à toute heure grâce à l’info en continu. Ses mots claquent, secs comme des coups de triques, des ordres aboyés, des mots d’ordre relayés, un appel à l’ordre et un rappel à la loi.
Le président lui-même ouvrit la bouche et tous les micros se tendirent pour mettre en scène la parole républicaine. Les lèches-cul et autres suceurs de pets des puissants se gargarisaient des annonces gouvernementales, avalant avec ou sans vergognes la petite musique du pipeau régalien, avant de la répéter à l’envie, d’en fredonner encore et encore la ritournelle doucereuse. Tous et toutes n’avaient que ça à la bouche ou par-dessus les oreilles. L’allocution de la bouche étatique était rabâchée de bouche en bouche, passait de bouche à oreilles, en rebattait les oreilles en bruissant des unes aux autres. La première des bouches avait entendu les maux des oreilles (parole de président! cochon qui s'en dédit) et dès que possible, des oreilles feraient leur entrée au gouvernement. Mais il ne put s’empêcher de distiller sa haine de classe : « Le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un porte-voix chargé et ceux qui écoutent. Vous, vous écoutez. », lança-t-il à quelques badauds qui l’interpellèrent. L’annonce ne calma qu’une frange infime de la masse auditive, et déjà on ne retenait que la pique, telle une tâche de nicotine sur le col d’une chemise blanche. Et la petite phrase raffermit la majorité qui voulait renverser la table, qui voulait tout changer… pour que rien ne change. Les oreilles voulaient prendre la place des bouches en les remettant à leur place. Déjà de la foule anonyme des oreilles certaines tentaient de prendre la tête, sans la perdre. À trop s’écouter, ces oreilles étaient prêtes à faire rentrer le désordre des être dans l’ordre des choses. De gauche à droite, les discours se brouillaient, fusionnaient dans la confusion de l’impensée. Trop d’oreille se rêvaient absolues. Et déjà guettait la rechute dans les banlieues.
MENTAL BLOCKS FOR ALL AGES – Dog faced Hermans, 1991

Notre homme avait convié le collectif chez lui et iels tentèrent de tirer du maelstrom chaotique des évènements une ligne à suivre. Ainsi que l’avait dit Virginia, leur parole avait été inaudible, recouvert par les voix des grandes gueules nées de l’émeute. Les bouches dissidentes elles-mêmes n’avaient pu imposer leur discours réformistes. La colère des oreilles était sourde à toute tempérance et n’avait pour cible que les bouches. Les autoritaires de tous bords savaient encore murmurer les promesses qu’espéraient les oreilles. Tout haut-parleur vit au dépends de cellui qui écoute. À bon entendeur… Le monde n’était plus que bouches et oreilles. Des bouches qui parlent sans jamais entendre, des oreilles qui écoutent sans toujours rien dire. Et la course au pouvoir était lancée. L’homme qui court veut arriver le premier, celui qui marche veut arriver là où il le souhaite.
Ce que la double métamorphose donnait à voir, renchérit notre homme, c’était l’invisibilité, dans le monde réel, des bouches. Les bouches, omniprésentes à l’écran ou à l’antenne, étaient, dans les rues, les supermarchés, dans les bureaux, les usines, dans les magasins, les tribunaux, les prisons, aux volants des voitures particulières, quasi absentes. L’invisibilisation des oreilles dans les médias sautait maintenant aux yeux tant les bouches paraissaient perdues dans la masse des oreilles de la rue. Mais la double métamorphose dévoilait le véritable visage de ce capitalisme que l’on disait à figure humaine. Le masque révélait des lèvres pulpeuses, des dents acérées et une langue chargée d’histoires ne demandant qu’à se raconter une nouvelle fois. Et aucun traits saillants sur un visage lisse.
Une autre évidence sauta aux yeux du collectif. Les métamorphoses des visages avaient considérablement réduit l’espace dévolu au cerveau. Les bouches avaient dévorer tout le haut de leur crâne, et l’espace entre les oreilles étaient aussi fin qu’une feuille à rouler. Bouches et oreilles avaient perdu l’esprit. Ne restait plus que la lettre. Lettre, quelque qu’elle fut, à laquelle se raccrocher en boucle en bouche, et reçue et vénérée par l’auditoire. Bref, la grande absente de cette métamorphose était bel et bien la conscience. Un équilibre s’était rompu. Était-ce le fait de la métamorphose ? Ou la métamorphose était-elle la conséquence de ce déséquilibre ? La question n’était pas là. La question était cet équilibre perdu. Et cet équilibre se devait d’être dynamique. « La question n’est pas de remplacer les bouches par les oreilles, asséna Virginia. Tant que les relations sociales seront façonnées par le pouvoir des uns sur les autres, on en s’en sortira pas. Il s’agit de changer les relations en transformant l’ordre sociale. Et ça, ça ne se fait pas par l’émeute, par des manifestations revendicatives. Parce que l’une comme l’autre ne mène qu’à changer le groupe qui dirige, pas à instaurer un ordre sans bouche ni oreilles. Il faut que les oreilles aient le courage de parler et que les bouches apprennent à se taire. » Cat suggéra que ces relations nouvelles entre hommes et femmes, entre colons et colonisé.e.s, entre hétéronormés et sexualités alternatives, cet équilibre ne se trouvait pas en bouche, ni dans les mots qui en sortent. « L’équilibre est une histoire d’oreille interne. Ce que les oreilles ont en elles, c’est cet équilibre entre la parole et l’écoute, entre le silence et la transmission. C’est l’équilibre entre soi et le monde extérieur. » César continua : « La bouche est toute dévouée à exprimer pensées et désirs. Elle sait même en amour passer des mots aux actes. C’est peut-être l’un des rares moments où une bouche peut être à l’écoute de l’autre. Moments que, j’en mettrais ma main au feu, peu d’entre-elles prennent le temps d’apprécier à pleine dents. » Virginia reprit. « Croyez-en mon expérience féministe, à partir du moment où vous osez vous affirmer et que vous osez dire que pour que vous puissiez avoir votre place, les hommes, ou quelque soit le dominant face à vous, doivent céder de leur pouvoir, vous passez pour une extrémiste. Vous ne luttez plus pour l’égalité, dans la bouche de vos opposants, mais pour la suprématie de votre propre caste ! »
« Et puis, ne nous voilons pas la face, dit notre homme, les ordres des bouches, les injonctions sociales, qui tombent des grandes gueules ont besoin d’être écoutés, transmises et retransmises et ce rôle est partagé entre petites bouches et quelques zélées oreilles. De nombreuses oreilles se font répétiteurs pour leurs contemporaines un peu dure de la feuille. Et bien des bouches ne sont que de simples porte-paroles, incapables d’élaborer en propre, une pensée. » Lucrèce expliqua pour sa part qu’elle avait l’impression qu’en jouant la partition de l’autonomie, dans leur coin, iels perdraient le contact avec la masse. Mais Virginia répliqua que la masse n’était qu’un construction du capitalisme et qu’elle ne pouvait être un outils pour lutter contre lui.
« Si nous voulons que changent les relations, que ce ne soit plus le pouvoir sur mais bien le pouvoir de qui les façonnent, il faut continuer à forger nos solidarités, ici et maintenant. » Jack répondit : « Pas de chance, on a tiré le constat que nous ne pouvions plus le faire sous le poids des nouvelles lois. Alors, on fait quoi ? Et puis, si dans la rue les fachos s’imposent et entrent au gouvernement, il y a peu de chance qu’ils nous laissent plus de place pour lancer nos initiatives… Bien au contraire. Et j’ai bien peur que nous n’ayons pas les forces pour mener à la fois la lutte contre la tempête qui vient et l’instauration de nouvelles relations sociales. » « Justement ! Ne partons pas dans des idées stratosphériques, ne soyons pas des astronautes ! Gardons les pieds sur Terre, les pieds dans la merde du quotidien ! », tança Virginia. « Pensons au Sisyphe heureux de Camus ! Chaque jour gravissons le tas de merde et peut-être qu’un jour du haut du sommet de la montagne nous apercevrons le monde pour lequel nous nous battons » asséna Lucrèce. « Nous ne nous battons pas parce que nous voulons gagner, mais parce que nous n’avons d’autres choix. », ajouta Virginia. « Et puis, qui sait, à force de gravir la même colline, peut-être comprendrons-nous ou verrons-nous qu’il existe un chemin pour contourner ce tas de merde pour rejoindre la vallée... du Pendjab où s’ébrouent des monstres heureux au rythme de la liberté », poursuivit notre homme dans un sourire fatigué.
Après de longues heures de palabres, iels prirent plusieurs décisions d’affilée : maintenir et renforce les initiatives de solidarités déjà mises en places, tenter de créer des liens avec d’autres initiatives similaires... et de se lancer à l’antenne : une radio pirate à l’ancienne, nommée « Ballade pour Bhopal ». C’était une référence à la fois à cette ville du Sud, à la catastrophe de l’Union Carbide qui y tua des milliers de personnes (sans qu’aucun responsable ne soit jugé) et à un vieux groupe écossais : The Dog Faced Hermans. « Il est temps ! Il va falloir communiquer avec d’autres, échanger nos points de vue et mutualiser nos ressources, fédérer nos actions. » lança Cat. « Il nous faut une stratégie de l’esprit et un corps stratégique », renchérit Jack. César cita Roland Barthes : « Le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire ». « Tout en empêchant de faire », rajouta Virginia avec une dose d’ironie. Notre homme, lui, se référa aux zapatistes : « C’est juste avant l’aube que la nuit est la plus profonde ». Après un dernier verre, chacun.e partit se coucher.
Dans l’intimité de la chambre, notre homme se déshabillait sous le regard de Virginia. Il lui demanda : « Qu’est-ce que tu as voulu dire quand tu disais que c’était pas tant le fait d’être bouche ou oreille, mais la relation sociale qui en découlait qui était important ? »
- Exactement ça !
- Ok, mais c’est comme si tu disais c’est pas le bourgeois le problème ou le prolétaire, c’est la relation de domination qui existe entre ces deux catégories. Pour qu’il n’y ai plus de domination, il faut bien abolir la bourgeoisie…
- Sauf qu’il faut abolir le prolétariat aussi. Si on considère le prolétaire comme celui ou celle qui vend sa force de travail aux bourgeois… pour construire le monde de consommation.
- Ben il disparaît avec l’abolition de la bourgeoisie.
- Ça reste à prouver ! Si le prolétariat continue à s’organiser pour produire sous un mode capitaliste, et même si les classes disparaissent, le monde qui les avait engendré perdure. Elles se recomposeront tôt ou tard. Mais pour autant, l’idée n’est pas d’éliminer physiquement toute la bourgeoisie. C’est bien la relation de domination/soumission qui doit être aboli. Imagine qu’en tant que féministe, je te dise que le problème ce sont les hommes… ça ne signifie pas qu’il faille tuer tous les mecs. C’est l’archétype masculin qui doit être aboli, en même temps que l’archétype féminin.
- Ok, je vois. Mais en même temps, le contexte matériel ne fait pas tout. On le voit à travers l’histoire. Dans des circonstances similaires, des groupes humains se sont organisés différemment. L’agencement matériel ouvre des perspectives, elles ne déterminent pas de certitudes.
- Bien sûr. Il ne s’agit pas d’imposer des façons de faire, mais bien d’ouvrir un nouvel âge du faire. Je ne parle pas de relation interpersonnelle mais bien de relation dans un contexte social. Prenons le couple hétéronormé. Il y a deux grandes façon de s’y inscrire. Soit on joue le jeu des normes sociales qui y sont rattaché, avec l’homme et sa bobonne, soit un modèle alternatif. Le mensonge de la relation interpersonnelle, c’est que ça n’existe pas. Aucune relation ne peut s’extraire de la société dans laquelle elle prend place. On nous fait croire que l’amûûr dissout les relation de pouvoir. Le prince qui épouse la servante, Roméo et Juliette, les mariages mixtes… La relation amoureuse aurait le pouvoir de faire disparaître les différences de classes, de races, etc. Et plus encore, on nous fait croire que l’amour fait disparaître les relations de dominations patriarcales. Regarde-nous. Je sais que tu es à l’écoute, que tu es loin des clichés du gros macho… pour autant, tu reste l’homme et moi la femme aux yeux des autres. Avec tous les attributs que portent nos genres. Si dans une soirée tu me gueulais dessus. On dirait que je t’ai poussé à bout, que je suis chiante. Si moi je pète un plomb, je passerai pour l’hystérique de service et on te plaindra. Si on reçoit des potes et que tu fais le bouffe, que tu sers, ça ne sera pas vu comme de l’égalité dans notre couple, mais on dira que tu m’es soumis.
- D’accord je vois. Si tu prends la parole, c’est que tu me la prend.
- Oui, mais ça va encore plus loin. Si je prend la parole, non seulement aux yeux des autres je te prive de ta parole, mais en plus ma parole n’est pas reçue pour ce qu’elle est. Soit on ne va pas m’écouter, jugeant que je ne peux avoir quoi que ce soit d’intéressant à dire, soit on va m’écouter en mode « oui, c’est bien ma fille. ». Bref, soit on est la fafemme qu’il faut protéger, soit on est la fafemme qu’il faut dominer. C’est de cette relation qu’il faut sortir. Je n’ai ni besoin qu’un homme me domine ni qu’il me protège. Je veux l’égalité. De la même manière, toute cette ambiance dans la manif, cette volonté de prendre la place des bouches… ça me dégoûte !
- Oui, déjà on commence à le voir, les oreilles qui prendrait la place des bouches se transformeraient en bouches. Et ça ne réglerait rien. Un peu comme le prise du pouvoir. La révolution ne doit pas être la prise du pouvoir mais sa destruction. Changer le monde sans prendre le pouvoir, comme le démontre les zapatistes ou les kurdes au Rojava.
- C’est ça. Mais ça n’a rien de facile. Déjà on voit dans quel état d’esprit est le mouvement anti-bouche. Et regarde, même dans notre petit collectif. Tu te souviens de l’attitude de César quand Lucrèce nous a dit avoir vu une oreille et avoir été victime de sexisme ?
- Oui, son sourire paternaliste lui bouffait la moitié du visage.Tiens, c’est comme… tu n’étais pas là… Mais Jack, quand on a discuté des métamorphoses le premier soir, je sais plus, il parlé de SES meufs. Ben pareil… Il a eu un sourire qui commencé à lui barrer toute la gueule.
- Oh mais tu n’est pas non plus exempt de tout reproche. Alors que Lucrèce était bouleversée par les propos sexistes, tu ne l’écoutais pas. Tout ce que tu voyais c’était l’apparition d’oreilles.
- C’est vrai ? Merde, je m’en étais même pas rendu compte. J’étais tellement dans ces histories de métamorphoses depuis des jours qu’il n’y avait plus que ça. Et après le choc d’avoir vu une bouche en pleine rue, que Lucrèce nous dise avoir vu une oreille…
- Mais tu sais, il y a plein de moments où tu es une bouche avec moi. Bien sûr, tu n’en est pas une qui parade à la télé, tu n’es pas un flic grande gueule, mais dans notre relation, je te vois comme une bouche. Mais même moi. Par rapport à plein de meuf, je suis une grande gueule. J’ose l’ouvrir face aux mecs. J’ai un bagage intellectuel qui me permet de pas me laisser faire dans plein de circonstances. Je suis blanche, économiquement, je m’en sors plutôt pas mal. Enfin, moins mal que beaucoup d’autres. Moi aussi je suis une bouche. Mais n’empêche que dans une relation face à un homme, je reste une oreille. Même si je gueule.
- La métamorphose est dans le regard, et dans la subjectivité qui va avec.
Notre homme baillait.
- Subjectivité… Oui, mais il y a quand même une bonne dose d’objectivité dans le regard, quand même. Dans le sens où un regard est situé socialement. Encore une fois, ce n’est pas tant d’où on regarde qui compte, que ce que la place d’où on regarde donne comme crédibilité ou privilège. Bref, il ne s’agit pas tant dans cette histoire de bouches et d’oreilles de prendre la parole, comme on prendrait le pouvoir, mais de la redistribuer, de ne plus en faire un privilège. La parole est un pouvoir, quoi qu’on fasse. Un pouvoir de transformer le monde. Il ne doit pas être un pouvoir sur, mais le pouvoir de… Bon, je suis morte. J’éteins ?
Posé sur l’oreiller, dépassant de la couette, une grande bouche en cœur, notre homme ronflait comme un sonneur. Elle éteignit, se lova contre lui. La pénombre plongea la maisonnée dans le silence et elle s’endormit sur ses deux oreilles.